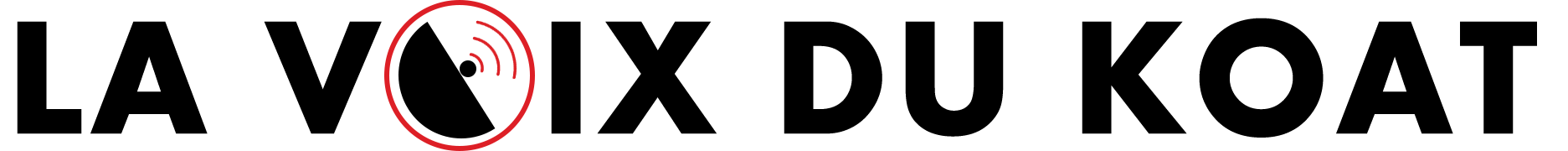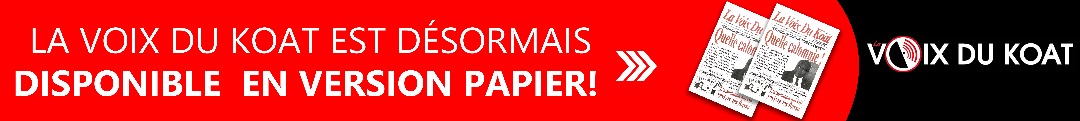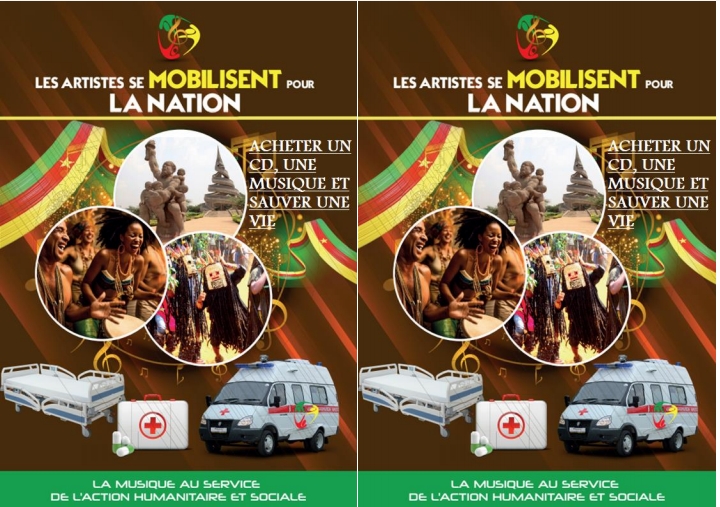L’inspecteur pédagogique régional de l’électrotechnique pour le Littoral soutient que depuis l’accession de Paul Biya au pouvoir en 1982, la Philosophie qui gère le Cameroun est l’ethnofascisme, porteur des germes de tribalisme. L’auteur de l’ouvrage « Changer le Cameroun par la Philosophie: du tribalisme à l’émergence » explique pourquoi il est impératif d’enseigner la Philosophie d’intégration dans le cursus scolaire et académique.

C’est un coup de tonnerre qui a retenti sous le ciel de Yaoundé. Un électrotechnicien rompu à la tâche s’appuie sur la Philosophie d’intégration pour battre en brèche trois penseurs pas des moindres et leurs collatéraux. Maurice Djiongo adosse son référentiel heuristique et herméneutique sur le nouveau paradigme de l’éducation articulé autour de l’approche par compétence. Question de persifler et de châtier les relents d’ethnocentrisme ayant cours dans la société camerounaise contemporaine. Après avoir fait un diagnostic, sans complaisance, des théories et des paradigmes d’antan arc-boutés autour de l’ethnofascisme, l’actuel inspecteur pédagogique régional de l’électrotechnique pour le Littoral frappe un coup de pied dans la fourmilière dans son ouvrage intitulé « Changer le Cameroun par la Philosophie: du tribalisme à l’émergence ».
D’après ce ferru et mordu du concept Web et communication, H. Mono Ndjana est le premier agrégé de Philosophie, dont il passe au scanner l’idéologie ethnofasciste, laquelle remonte à la moitié des années 80. M. Djiongo soutient: « La Philosophie qui gère le Cameroun est l’ethnofascisme auréolé des relents de tribalisme”. Les ouvrages des trois esthètes de la pensée qui sont au banc des accusés sont illustratifs de l’enfermement, voire de l’enlisement dans le carcan ethnique, voire ethnocentriste. « L’idée sociale chez Paul Biya » du Philosophe Mono Ndjana, « Le dynamisme bamiléké » du Géographe Jean-Louis Dongmo et « La protection des minorités et des peuples autochtones du Cameroun » du Juriste James Mouangue Kobila sont trois manuels qui, selon Djiongo, « doivent être retirés des bibliothèques » parce que imbibés de la sève ethnocentriste et ethnofasciste.

L’auteur se pose, d’ailleurs pour s’en préoccuper, la question de savoir s’il est possible d’atteindre le stade de l’émergence avec des velléités tribalistes. Comment pouvons-nous arrêter ce syllogisme qui tue ce raisonnement, qui débouche sur des déclarations du genre « Les Beti sont au pouvoir et les autres ethnies doivent attendre », « les Bamiléké sont dynamiques », « les Bamiléké sont des envahisseurs », « Les Bamoun sont allogènes dans le Sud », « les anglophones sont à gauche » ou encore « les Bassa sont méchants et marchent avec le timbre de 500 Fcfa ». « Peut-on parler d’émergence dans un pays où le tribalisme est érigé en mode d’animation de la vie sociopolitique? » S’interroge le Philosophe de l’intégration. Mû par une triple méthode psycho-affective, cognitive et intégrationniste, M. Djiongo s’affranchit, sans coup férir, des sentiers de l’approche par contenu aujourd’hui obsolète pour cibler l’approche par compétence nourrie de trois invariants: le savoir; le savoir-faire et le savoir-être. Grâce au savoir boursouflé de la sapientia, voire de la bene di scientia (science de la rhétorique), les concepts chers à la Philosophie biyaiste du Renouveau sont passés au crible de la raison pratique. « Rigueur et moralisation », « Pour le libéralisme communautaire », « Les grandes ambitions », « Les grandes réalisations », « Santé pour tous en l’an 2000 » et « L’émergence en 2035 » sont, a posteriori, des slogans creux et pompeux tant la lisibilité, la traçabilité, la factualité et l’opérationnalité n’ont guère été perceptibles.
A la faveur du savoir-faire, tout chercheur fait étalage de ses aptitudes professionnelles grâce auxquelles il s’impose dans la division du travail capitaliste. Le savoir-être, sève nourricière du logiciel mental, permet, ontologiquement, de se débarrasser des oripeaux de l’ethnofasciste pour arborer la toge du Philosophe de l’intégration. Quiconque quittera alors la sphère du tribalisme pour le creuset de l’émergence. Ainsi sortira-t-il du bourbier de l’émotionnel pour parvenir aux cimes du rationnel. En se décidant donc à évacuer les situations à problème au bénéfice des situations d’intégration, M. Djiongo interpelle les neuf leaders politiques prétendants à la magistrature suprême dans l’optique de les inciter à intégrer, dans leur projet de société politique, les revendications globales liées à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail et, spécifiquement, à l’augmentation de leur rémunération. Le ré-ajustement salarial est, pour M. Djiongo, la condition sine qua non pour la résolution des problématiques conjoncturelle et structurelle de ses pairs enseignants. Toute chose justifiant la lettre ouverte adressée à ses concitoyens enseignants qui doivent, dans une dynamique collégiale, agréer et accréditer leur courant de pensée dans le dessein de remédier à leur mal-être sociétal existentiel. L’élection présidentielle du 7 octobre 2018 est, pour ainsi dire, une occasion opportune, pour les peintres du tableau noir par vocation, de se coaliser et de faire chorus pour imposer leur vision du monde à tous les postulants à la présidentielle. Vivement que 36.000 enseignants camerounais fassent foule, restent et demeurent unis à l’image ses prolétaires du monde capitaliste de Karl Marx.
Bon vent Maurice Djiongo!
Serge Aimé BIKOI journaliste et Sociologue du développement