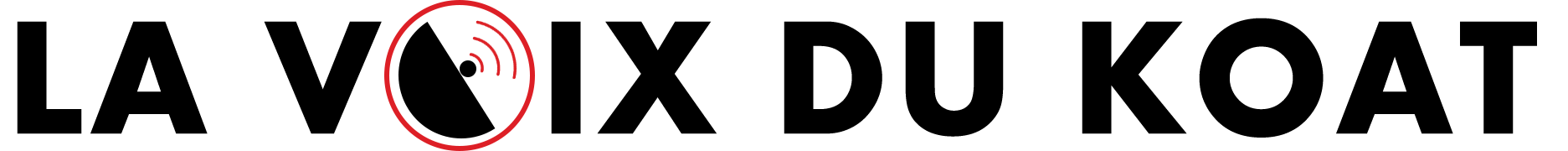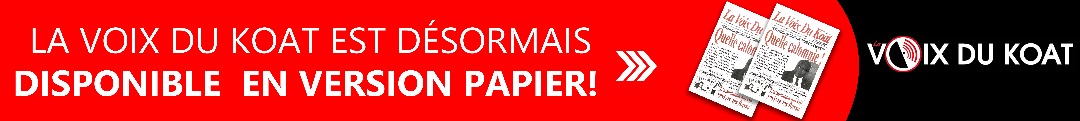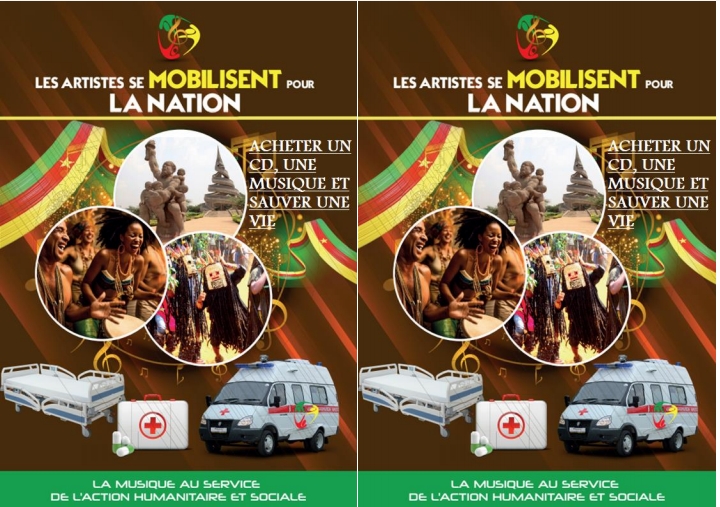La dernière grande actualité qui a clôturé la semaine dernière, est sans nulle doute l’arrivée de l’ancien ministre de la Défense Edgard Abraham Alain Mebe Ngo’o à la prison central de Kondengui à Yaoundé, après deux longues nuits de procédure au tribunal criminel spécial. Fin d’un épisode. D’aucun s’en réjouissent certainement, d’autres pleurent. Mais la question ultime que les Camerounais se posent est triviale : Il est en prison, et puis quoi ? La même question se pose d’ailleurs depuis que l’opération épervier a permis de mettre tout un gouvernement en prison, selon l’ossature camerounaise. De Premier ministre à simple directeur de société.
Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité parce qu’avec ce nombre impressionnant de personnalités en prison, la corruption n’a pour autant pas disparu dans l’administration camerounaise. Elle continue de bien se porter au contraire. Sur la route, dans les bureaux, dans les marchés publics, à la douane, on ne vit que de la corruption. Et si elle se porte autant bien, c’est que comme tout ce qui vit, elle est entretenue et nourrie. Par qui, comment et pourquoi ?
Quand la corruption reste entretenue
Par qui ? Simple à répondre, par le système gouvernant qui dispose entre les mains tous les outils pour tuer cette corruption s’il le veut. Ces outils, ce sont les textes. Ces textes ont créé par décret n° 2005/187 du 31 mai 2005 l’agence nationale d’investigation financière, l’Anif, en lui donnant pour mission, la lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT). Ces mêmes textes ont créé la Commission nationale anticorruption par décret n° 2006/088 du 11 mars 2006 avec pour mission de contribuer à la lutte contre la corruption, d’après l’article 2 du décret. Avant la création de ces organes, la Constitution du 18 juin 1996 avait déjà prévu à l’article 66 l’obligation de déclarations des biens à tous gestionnaires de la fortune publique.

Et comment ce système entretient la corruption ? En trois étapes au moins : d’abord par le refus d’appliquer les textes comme l’article 66 de la Constitution. Ensuite en vidant les organes créés dans le cadre de la lutte contre la corruption de tout pouvoir coercitif et de poursuite. L’Anif par exemple, d’après l’article3 du décret de création, a pour mission de recevoir, de traiter et, le cas échéant, de transmettre aux autorités judiciaires compétentes, tous renseignements propres à établir l’origine des sommes, ou la nature des opérations faisant l’objet de la déclaration de soupçon au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.De même pour la Conac, l’article 22 de son décret de création stipule à l’alinéa 2: «En cas de constatation d’actes ou de faits susceptibles d’être qualifiés de corruption ou de tout délit connexe, la Commission réunit les éléments de preuve et transmet le dossier constitué au président de la République pour les décisions appropriées.»
Lire aussi : Opération Epervier : Edgar Alain Mebe Ngo’o à Kondengui
Laxisme et laisser faire
Enfin, la corruption est également entretenu par le laxisme et le laisser faire. Que de rapports de la Conac ont été transmis à la présidence de la république, citant nommément de personnalités impliqués dans les détournements des fonds, la corruption et autre, sans que suite n’y soit donnée. Le 19 novembre 2018, à l’occasion du séminaire national sur le risque de blanchiment de capitaux, à Yaoundé, le directeur général de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF), Hubert Nde Sambone faisait un bilan de l’organisme qu’il dirige sur la période 2017-2018 en ces termes : «Si vous jetez un coup d’œil sur notre rapport d’activité, vous allez vous rendre compte qu’il y a des cas de blanchiment qui ont été identifiés et les rapports ont été transmis aux autorités judiciaires compétentes. Nous sommes aujourd’hui pratiquement à 5000 dénonciations reçues et à environ 700 rapports transmis aux autorités judiciaires. Pour ce qui est de l’évaluation financière, c’est en milliers de milliards de francs CFA.»
Si l’Anif parle de 700 rapports transmis sur la période 2017/2018, c’est dire qu’elle reste vigilante. Car lorsque ces ministres aujourd’hui incarcérés font venir des véhicules de 300 millions, cela laisse la traçabilité au Port et à la douane. Quand les prévaricateurs de la fortune publique dressent des immeubles et des châteaux dont les coûts avoisinent le milliard, les services compétents sont bien au courant, que ce soit par les rapports des organes spécialisés ou par les renseignements. Pourquoi laisse-t-on faire alors ?
A quoi sert-il aux Camerounais que l’on laisse certains piller les caisses de l’Etat, faire des surfacturations, passer des marchés des milliards de gré à gré avec en sous-main des retro-commissions, pour après mobiliser d’importantes ressources financières et humaines pour procéder à leur arrestation ? Lire aussi :Opération Epervier : Mebe Ngo’o, l’autre chute d’un dinosaure
Prévenir, au lieu de guérir
Pourquoi ne pas anticiper en appliquant les textes conte la corruption ? Pourquoi ne pas arrêter le massacre dès qu’il commence ? La lutte contre la corruption s’apparente finalement à de la théâtralisation, de l’instrumentalisation, pour ne pas dire la manipulation de ces hommes et femmes imbues d’eux-mêmes qui continuent malheureusement de ne pas comprendre : Ne pas comprendre que la signature d’un décret en leur faveur est aussi le début d’un processus qui peut aboutir à la signature d’un mandat de dépôt, en passant par le retrait du passeport, l’interdiction de sortir du pays, les convocations au Tribunal spécial et les longues nuits d’audition par des juges.
A la fin, Arrêter le voleur, même s’il restitue le corps du délit, ne répare pas le préjudice causé à la population. Une voiture de 200 millions achetée avec l’argent détourné des caisses de l’Etat, c’est l’équivalent de 40 forages à raison de 5000 000 l’un qui peuvent soulager des populations de n’importe quelle localité du pays. On peut multiplier des exemples de besoins élémentaires des populations qui ne sont pas satisfaites, alors que des gestionnaires de la fortune publique prennent l’avion pour aller soigner des maux de tête ou faire des courses, alors que dans certains coins, des enfants continuent de s’asseoir sur des morceaux de pierres pour prendre les leçons, derrière un tableau accroché à un arbre.
Empêcher le vol en amont serait plus productif et plus bénéfique pour la population, que de le punir en aval, ce qui s’apparente cette fois plutôt à un règlement de comptes entre les membres d’un clan, sans réel impact sur le vécu quotidien du citoyen lambda.
Roland TSAPI