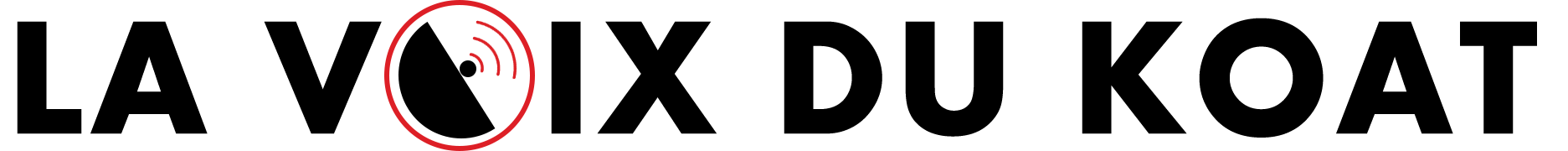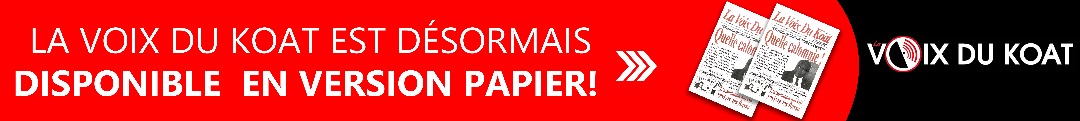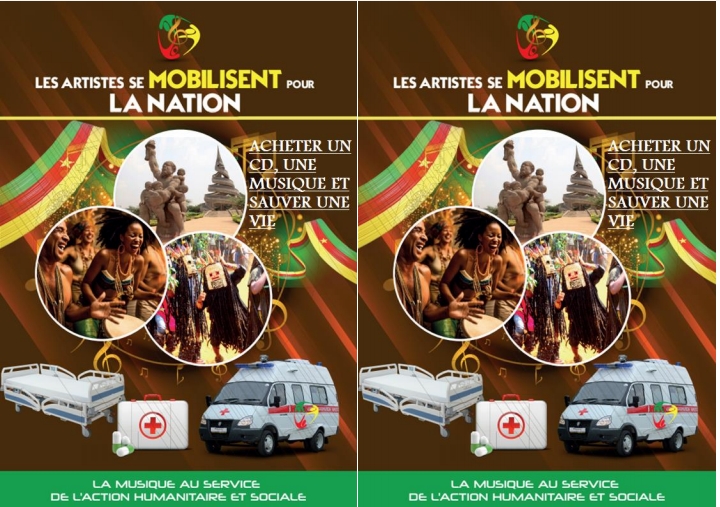Dans la précédente chronique, nous avons évoqué la qualité du service dans l’administration camerounaise, pour constater avec les plus hauts fonctionnaires encore en poste que le service public dessert les intérêts de l’Etat à tous les niveaux, tandis que les intérêts individuels étaient protégés. Et tant que cette situation durait, les normes élaborées et proposées pour l’évaluation ne seraient que des coups d’épée dans l’eau, ou plus exactement des moyens de plus pour poncer les caisses de l’Etat comme ce fut le cas pour le Sigipes I et II.

En réalité, le nœud du problème c’est l’impunité. Le système est fait de sorte que l’on sache toujours où est la faute, qui l’a commise, comment et avec quelle complicité. Mais au lieu d’appliquer une sanction exemplaire, l’on ouvre plutôt un enquête pour soit disant établir les responsabilités, comme si dans une structure, un service ou un département il y avait autre responsable que le chef.
Faisons un arrêt sur la corruption dans les services. Après avoir longtemps cherché les preuves de l’existence de ce fléau dans l’administration, le président Paul Biya a créé par décret nº 2006/088 du 11 mars 2006 la Commission nationale anticorruption, en abrégé Conac, en remplacement de l’Observatoire national des élections, dissoute. La Conac devient opérationnelle le 15 mars de la même année, avec la nomination de son premier président Paul Tessa, de regretté mémoire. Ses missions sont nombreuses, qu’on pourrait simplement résumer en la lutte contre ou pour la corruption c’est selon l’angle de vue. Dans l’exécution de cette tâche, l’organisme fait le tour des services publics quand les moyens lui permettent, et encourage chaque ministère et autre institutions publiques comme les hôpitaux à installer en leurs seins des cellules de lutte contre la corruption. Même comme ces cellules sont plutôt devenues des nids supplémentaires de corruption. Cet organisme a par ailleurs élaboré depuis 2010 un document de 227 pages intitulé Stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ce document devait mettre l’accent sur les secteurs du Budget d‘Investissement Public et des Marchés Publics, de la Décentralisation, de l’éducation, de l’Environnement et Forêts, des mines et des industries extractives, de la Santé publique, des Transports et enfin des Finances qui englobe la Douane, Impôts et le trésor. Cette stratégie devait s’étendre jusqu’en 2015.
Plus on lutte contre le fléau, plus il prend corps
Si dans le classement 2015 des pays le plus corrompus, le Cameroun est passé à la 19ème place au niveau africain et à la 33ème place au niveau mondial, ce qui est perçu comme une amélioration, cela ne se ressent pas à l’intérieur, d’après la perception des usagers. Chose surprenante en plus, il y a des ministères qui font tout pour empêcher la lutte contre la corruption en leur sein. C’est en tout cas, ce qu’a relevé Dieudonné Massi Gams le 29 décembre 2016 à Yaoundé, lors de la présentation du Rapport sur l’état de la lutte contre la Corruption au Cameroun en 2015. Selon lui, 11 départements ministériels ont refusé de coopérer durant l’année 2015 dans la recherche des indices de corruptions. Parmi ces ministères, celui de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, arrive en tête. Suivi du ministère de la Défense, du ministère des Relations extérieures, du ministère des Finances et du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Il y a également le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, le ministère de l’Eau et de l’Energie, le ministère des Transports, le ministère des Sports et de l’Education physique, le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Communication. Massi Gams a expliqué que cet état de choses déplorable tient tantôt à l’inexistence formelle des cellules de lutte contre la corruption dans ces Instituions, tantôt à leur léthargie là où elles existent. Et de finir par rappeler à tous les patrons de ces départements ministériels que « la lutte contre la corruption n’est pas facultative. Il s’agit d’un engagement fort du Chef de l’Etat et par conséquent, les différents segments de la société camerounaise tout entière sont chargés de son implémentation ».
Sauf qu’après ces discours, les choses sont revenues à la normale. Pas de réaction du Président de la République. Depuis 2015 que des ministres ont publiquement été accusés de faire des blocages à la lutte contre la corruption, ils n’ont pas été inquiétés. L’impunité perdure, et quand les employés d’un ministère savent que leur patron va faire obstruction quand la Conac frappe à la porte, ils se sentent protégés et encouragés dans la pratique. Pas étonnant qu’à la fin, plus on lutte contre le fléau, plus il prend corps, et la qualité du service public de plus en plus médiocre. Quand on se souvient qu’il y a moins d’un mois en France, Emmanuel Macron a retardé la publication de son gouvernement de 24 heures pour être sur que ses ministres ne traînent pas des casseroles, et que chez nous les ministres en poste empêchent les missions de contrôle et restent en place, on comprend que le chemin est encore long. Tant que l’impunité restera, les corrompus et les fonctionnaires véreux vont continuer à narguer les usagers avec ce proverbe africain, d’après lequel « le coassement des grenouilles n’empêche pas l’éléphant de boire. »
Roland TSAPI, Journaliste