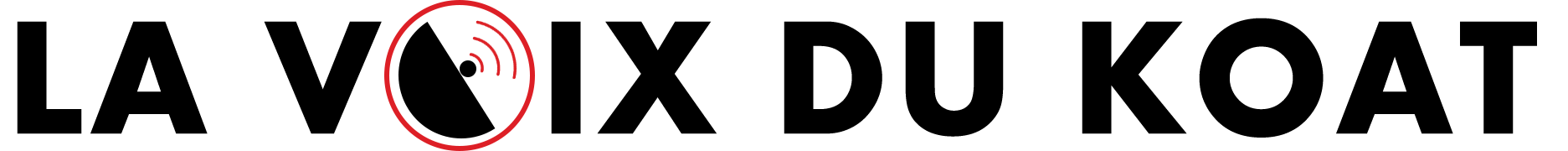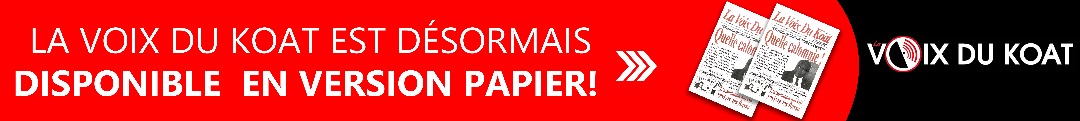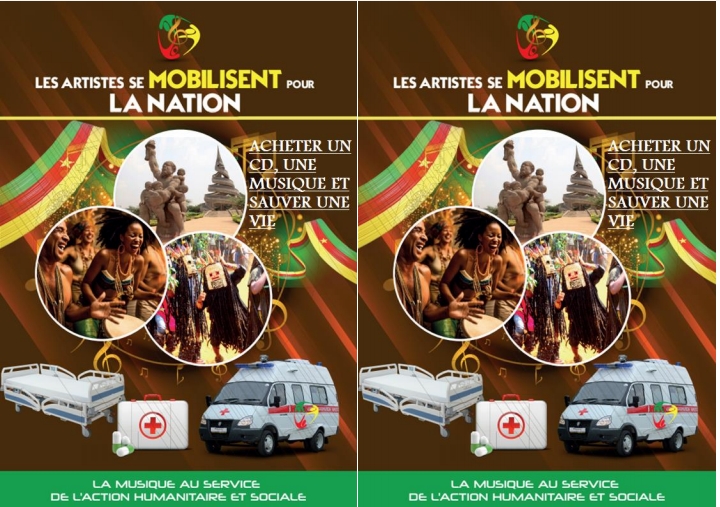Par Gérard KAMENI, avocat au Barreau du Cameroun
Avertissement : la présente réflexion quoique le fruit de l’imagination créatrice de son auteur se veut purement heuristique et la référence faite à une affaire qui mobilise l’opinion publique n’est qu’un prétexte pour questionner dans une perspective épistémologique la philosophie qui sous-tend le pardon dans le système judiciaire camerounais en général et répressif en particulier. Il ne s’agit dont pas d’élaborer un blueprint ou des espèces de prolégomènes pour disculper l’auteur de « l’urgence de la pensée » et de ses acolytes : loin de moi pareille outrecuidance, je n’en ai ni les ressources ni les capacités encore moins la prétention. Le Président Biya dans l’un de ses discours disait : « La démocratie est une école de tolérance « . (Cf.Clébert Njimeli, Le discours de Paul Biya à l’ère du Multipartisme au Cameroun, mises en scènes argumentative et relation au pouvoir, Thèse de Doctorat, Bordeaux Montaigne, 3 avril 2018). Le moment n’est-il pas venu pour NOUS, peuple camerounais de nous approprier cette pensée ?
ET SI ON REVENAIT AU SUJET !
Ça fait un bout de temps que le Cameroun est devenu otage de deux actualités majeures : la crise anglophone et l’embastillement de certaines figures emblématiques de la scène politique. Le Prince lui-même semble d’autant plus préoccupé que ses différentes sorties sur les réseaux sociaux notamment sur twitter sonnent comme une volonté de décrispation de l’arène sociopolitique et une exhortation à fumer le calumet de la paix. Et si l’hypothèse du PARDON était mobilisée à cette fin?
Le PARDON, voilà un mot mangé à toutes les sauces, galvaudé parfois abusivement utilisé. Au-delà de ses origines cléricales, il recouvre pourtant au point de vue juridique une acception toute particulière. Au sens étymologique le pardon est d’abord un don. Mais c’est un don total, entier, parfait comme l’indique le préfixe par (du latin per). “Par–donner”, c’est donner complètement, c’est “tout donner”. Il semble d’ailleurs que l’origine du mot « pardon » et ses premières attestations latines « perdonare » renvoient à l’idée de “faire grâce”, “laisser la vie sauve”.
Dans sa thèse de doctorat soutenue à Nice en 2012 et intitulée « le pardon en droit pénal » Caroline GATO souligne que le pardon en droit pénal demeure une institution originale et son application est controversée. D’où la question de savoir quelle est la philosophie qui sous-tend le pardon dans notre système répressif? Le Cameroun a opté pour une procédure à califourchon entre la procédure de type accusatoire qui consacre la présomption d’innocence et l’égalité des armes et la procédure de type inquisitoire qui confère au magistrat des pouvoirs énormissimes destinés à lui permettre de diligenter lui-même les investigations à charge et à décharge. Cette procédure de type mixte aux dires d’un esthète accompli du syllabaire universitaire, « essaie de concilier le respect des libertés individuelles et les nécessités de la répression ». (Lire Philippe KEUBOU, Précis de procédure pénale camerounaise, PUA 2010, p.22)
Au Cameroun, la sanction pénale remplit une triple fonction :
– La fonction d’intimidation : la gravité de la peine et la crainte d’un châtiment exemplaire doivent être de nature à décourager les potentiels délinquants.
– Une fonction de rétribution : la peine est juste la sanction de la faute commise ; on pourrait dire le juste salaire du délinquant.
– Une fonction de réadaptation : car, comme le fait remarquer l’Agrégé des facultés françaises de droit de 1973, le Pr. STANISLAS MELONE (1941-2000), dans « Les grandes orientations de la législation pénale en Afrique : le cas du Cameroun », R.C.D n°7, janvier-juin 1975 p.20,
« une répression qui ne se préoccupe pas de réadapter les délinquants fait une œuvre vaine et inhumaine ».
Il n’y a donc pas de mise en œuvre du Droit Pénal sans une prise en compte de la dimension humaine dans le traitement des délinquants. Voilà pourquoi PASCAL DIENER a écrit dans « Éthiques et Droit des affaires » paru en 1993 que « Le droit, tout le droit, même dans ses aspects les plus techniques, est toujours dominé par la morale dans la fonction normative « .
On peut donc légitimement se poser un certain nombre de questions:
– Pourquoi peut-on pardonner les actes d’un infracteur ?
– Peut-on accorder le pardon à tous les délinquants ?
– Le pardon peut-il intervenir à toutes les étapes du procès pénal ?
– Y a-t-il des hypothèses où le pardon est impossible ?
– Le pardon est-il total ou partiel, parfait ou imparfait ?
– Quel est l’objectif visé par l’esprit du pardon en Droit Pénal Camerounais ?
– Que serait notre système répressif s’il faisait fi de tout pardon ?
Toutes ces interrogations ont des réponses précises dans notre Droit positif et touchent à tous les aspects de notre système pénal.
Il y a lieu de souligner que l’esprit de pardonner dans la stratégie de lutte contre la criminalité a pour source première la LOI, pour source deuxième le JUGE, et pour source troisième la VICTIME.
D’abord La LOI parce que quand bien même l’infraction est consommée dans tous ses éléments constitutifs, il peut arriver qu’on se trouve dans l’IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE (l’exécution de la loi, l’obéissance à l’autorité légale, la légitime défense, l’état de nécessité, les immunités, l’arrêt des poursuites : « Le Procureur Général près une Cour d’appel peut, sur autorisation écrite du Ministre chargé de la justice, requérir par écrit puis oralement, l’arrêt des poursuites pénales à tout stade de la procédure avant l’intervention d’une décision au fond, lorsque ces poursuites sont de nature à compromettre l’intérêt social ou la paix publique ». On parle de « nolle prosequi ». Le pardon de la loi peut également intervenir après la condamnation des délinquants ou auteurs d’infractions.
On parle alors tantôt de la Grâce tantôt de l’amnistie, tantôt de la réhabilitation.
Ensuite, le JUGE: Celui-ci doit faire preuve d’une extrême vigilance dans un contexte où l’opinion publique s’est érigée en censeur des décisions de justice et considère que celles-ci doivent être soumises au « référendum populaire ». (L’expression : »référendum populaire » est empruntée au Ministre Laurent ESSO alors Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest, lors de l’installation des chefs de juridictions du Haut-Nkam à Bafang le 14 novembre 1981).
Au-devant du procès pénal se trouve donc le juge qui interprète les lois et dit le Droit. Sa mission est la plus apparente et son office est marquée par l’esprit du pardon. Autant il fait peur et sanctionne, autant la loi lui donne la possibilité de faire œuvre de clémence puisqu’il n’est pas un distributeur automatique des peines. Certes il n’est pas un ministre de culte, mais en prêtant serment devant Dieu, le juge s’engage à être miséricordieux dans l’accomplissement de sa mission.
Le pardon du juge passe donc par des circonstances atténuantes, les excuses atténuantes, les peines alternatives et la dispense de la Contrainte Par Corps.
Enfin le pardon peut curieusement émaner aussi de la VICTIME de l’infraction. Alors que la société attend sa réaction musclée par l’exercice des poursuites pénales contre son bourreau, la victime peut se refuser d’engager toute procédure ou bien même désister de son action.
Dans l’affaire KAMTO et compagnie les juges se souviendront-ils de ces propos tenu le 22 février 2018 par le premier président de la Cour suprême Monsieur Daniel MEKOBE SONE à l’occasion de la rentrée solennelle de cette auguste juridiction : « Le pardon, véritable droit de la miséricorde et de la pitié constitue dans la dialectique de répression–réadaptation, un instrument d’humanisation de notre justice pénale.
Il s’agit d’une alternative pour tempérer « l’énervement de la répression ».
Mais bien avant une décision au fond, le Prince est investi d’un pouvoir hyper-puissant lui permettant anesthésier l’énervement de la répression et de réconcilier le peuple camerounais avec lui-même : La « NOLLE PROSEQUI » ou suspension des poursuites.
Seulement une question se pose et je laisse le lecteur le soin d’y répondre : la » nolle prosequi » dans le cas d’espèce est contenue dans la loi du 17 juillet 2017 portant Code de la justice militaire. Or cette loi du point de vue de la hiérarchie des normes juridiques est accusée par la défense du tireur de penalty d’être anti-conventionnelle en ce qu’elle consacre
La justiciabilité des civils devant les tribunaux militaires ceci au mépris d’après eux des instruments juridiques ratifiés par le Cameroun notamment les Principes et directives sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique adoptés du 15 au 28 novembre 2007 à Niamey, au Niger à l’issue de la 33e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) de l’Union africaine. Le collectif pro bono qui assure la défense du chevalier des Palmes académiques du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) et Cie, capitulera-il au cas où un acte de l’exécutif pris sous le fondement de cette fameuse loi venait à prescrire l’arrêt des poursuites? L’hypothèse d’un écran législatif ou loi-écran est-elle à écarter ? (V. RAINAUD Jean- Marie « le droit au juge devant les juridictions administratives », in RIDEAU Joël, pp. 33-48.)
En d’autres termes la controverse sur la position/ place des traités et accords internationaux par rapport à la loi ayant été tranchée au plan légal par l’article 45 de la Constitution du 18 janvier 1996 et au plan jurisprudentiel par l’arrêt NICOLO du 20 octobre 1989 qui opposa jadis le Conseil d’État à la Cour de Cassation en énonçant la supériorité des traités sur les lois internes, quel serait donc le sort d’un décret prescrivant l’arrêt des poursuites pris sur le fondement d’une loi dont-on dit anti conventionnelle?
Redoutant de faire face à une éventuelle fin de non-recevoir de la Défense, le prince pourrait choisir de mettre en quarantaine son pouvoir d’instruire au ministre chargé de la justice militaire d’arrêter les poursuites et de laisser au tribunal le soin de vider sa saisine pour recourir a posteriori à la GRÂCE. Sauf qu’ici encore on pourra se trouver en face de deux difficultés :
D’abord l’élasticité du temps : la grâce présidentielle suppose non pas un jugement passé en force de chose jugée mais un jugement IRREVOCABLE c’est à dire insusceptible de voies de recours ordinaires et extraordinaires, or il y’a risque de craindre une détérioration de la situation sociopolitique (le juge n’étant astreint à aucun délai pour vider sa saisine).
Ensuite, en matière criminelle, le principe voudrait que ce soit au condamné qu’il revient de faire la demande de grâce comme ce fut le cas dans l’aff Lydienne Eyoum C/ État du Cameroun.(Cf. R MERLE, Droit Pénal Général complémentaire, PUF., 1951, p.374, LEMARCIER, les mesures de grâce et révision dans la législation récente, in RSC, 1947, 41 et S. J FOVIAUX, la rémission des peines et ses condamnation et droit monarchique et le droit moderne, PUF, Paris, 1970). Or, on voit mal le tireur de penalty solliciter la clémence du prince puisqu’il se considère désormais comme le Prince (Cf. les différentes sorties médiatiques de son porte-parole sur les plateaux tv/radio).
La sortie de l’auberge n’est donc pas pour demain. Le feuilleton s’annonce riche en rebondissements et la question initiale demeure : L’URGENCE DU PARDON ?