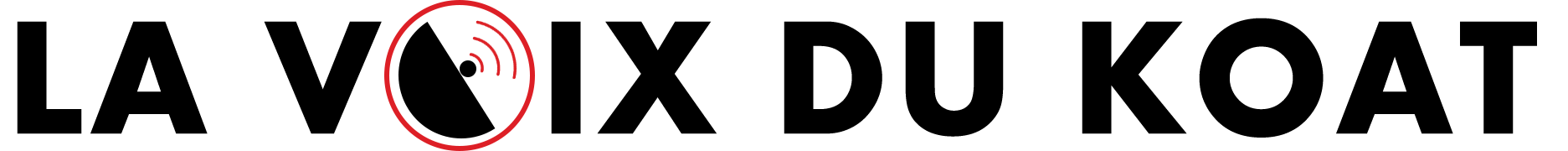« Prenez le commandement.» C’est avec cette formule que les gouverneurs, préfets et sous-préfets continuent d’être installés dans leurs fonctions au Cameroun. Une formule qui dès le départ comporte en elle-même les germes de la violence et de la répression.
Le mot commandement découle du verbe commander, qui entre autres définitions signifiait en latin « donner un ordre ». Dans les usages, il est plus connu comme un langage militaire ou des Forces de maintien de l’ordre, des différents corps dans lesquelles la discipline est de rigueur et l’obéissance à un ordre ne se discute pas. Il suffit d’ailleurs d’observer les pratiques dans ces milieux pour constater que pour répondre à un supérieur qui donne des instructions, c’est l’expression « à vos ordres » qui est utilisée. Au-delà des corps de l’armée et des forces de maintien de l’ordre, le commandement en droit désigne un acte d’huissier visant à sommer une personne à faire quelque chose ou à payer une dette. Dans le registre religieux on peut aussi évoquer les dix commandements de la Bible, qui sont des ordres donnés par l’être suprême et dont le respect scrupuleux ne devrait faire l’objet d’aucune négociation ni d’aucun questionnement, au risque de faire face à la colère divine.
Héritage colonial
Dans tous les cas, la notion de commandement fait allusion à la force, à la violence, l’autorité incontestable qui doit être imposée par tout moyen, d’où l’expression bâton de commandement. Mais comment arrive-t-on au Cameroun à utiliser le langage militaire dans l’administration ?
D’aucuns disent qu’il s’agit là d’un héritage colonial, du système français surtout. Dans un article intitulé « De la décolonisation…à la décentralisation. Histoire des préfets coloniaux » publié en 2001 dans Politix, Revue des sciences sociales du politique, Véronique Dimier dit : « L’exportation des fonctionnaires européens, de leurs cultures et de leurs méthodes de gouvernement vers les états colonisés a largement été étudiée…les colonies ont souvent été considérées comme un laboratoire où devait être expérimentée « l’administration de l’avenir. » L’auteur explique que la fin non prévue de l’empire colonial français posa un problème inédit, celui de la disparition et de la reconversion du corps des administrateurs coloniaux, une institution vielle de quelques quatre-vingts ans, rassemblant des hommes dont le pouvoir pouvait être difficilement transférable au sein de la France métropolitaine. Autrement dit, le pouvoir que ces administrateurs coloniaux exerçaient en Afrique ne pouvait pas être exercé en France. Conséquence, certains d’entre eux se lancèrent d’après Véronique Dimier à l’assaut des postes beaucoup plus prisés par l’élite administrative française, entrant de fait en compétition avec les élèves issus de cette école nouvellement créée pour former les hauts fonctionnaires, l’Ecole nationale de l’administration en abrégé ENA. C’est le corps préfectoral qui apparut comme le plus riche d’opportunités pour ces chefs en manque de commandement.

Enam, duplicata de l’Ena en France
Le modèle de gouvernement véhiculé par l’Ena et ses élèves étant celui « d’un état bureaucratique, centralisateur, où les agents territoriaux ne sont que les simples exécutants d’un droit uniformisateur et assimilateur. » L’Ena pour former les administrateurs en France. Au Cameroun on a juste ajouté la lettre M pour avoir l’Enam, l’école nationale de l’administration et de la magistrature, celle qui forme nos sous-préfets, préfets et gouverneurs. Le nom peut avoir changé en traversant les océans, mais l’objectif est resté le même, former des fonctionnaires qui devaient remplacer les administrateurs coloniaux rappelés en métropole.
André Soucadaux, Roland Pré, Pierre Mesmer, Jean Ramadier, Xavier Antoine Toré sont autant de gouverneurs français qui ont dirigé le Cameroun de 1950 à 1960. Dans un contexte de répression des luttes nationalistes, ils installaient les préfets des régions en leur donnant le bâton de commandement avec la fameuse formule, qui devait leur permettre de mâter sans pitié les populations rebelles. Mais depuis lors l’habitude est restée, les administrateurs continuent d’être envoyées dans les unités administratives avec pour principale mission le maintien de l’ordre public. La police et la gendarmerie qui ailleurs, sont sous les ordres de l’exécutif communal, ce sont les administrateurs qui disposent d’elles.
Lire aussi :Présidentielle : Projet de société/ Joshua Osih pour la fermeture de l’Enam
Le culte du chef
Au Cameroun de nos jours, les administrateurs tardent à se dépouiller du culte du chef qui leur a été inculqué à l’Enam, cette école que des voix s’élèvent d’ailleurs pour demander la refondation à défaut de la fermeture pure et simple et son remplacement par une école nationale de management. Parce que la société camerounaise a besoin aujourd’hui des managers et non des administrateurs avec le bâton de commandement, pour qui on doit se lever quand ils entrent dans une salle ou au bureau.
Même dans l’armée aujourd’hui, l’accélération du changement social rend l’exercice du commandement complexe, amenant les décideurs militaires à faire preuve de multiples compétences pour faire adhérer ses subordonnées et mener à bien les missions confiées. La colonisation est révolue il y a bientôt 60 ans, le colon est rentré chez lui et a même été obligé de se reconvertir pour être intégré. Il est temps, plus que jamais temps dans un Etat qui se veut moderne, que les sous-préfets, préfets et gouverneurs, laissent le commandement pour prendre le leadership de leurs unités administratives respectives, car le leader lui, comme le dit Charles Handy, «doit convaincre de faire, et non donner des ordres».
Roland TSAPI