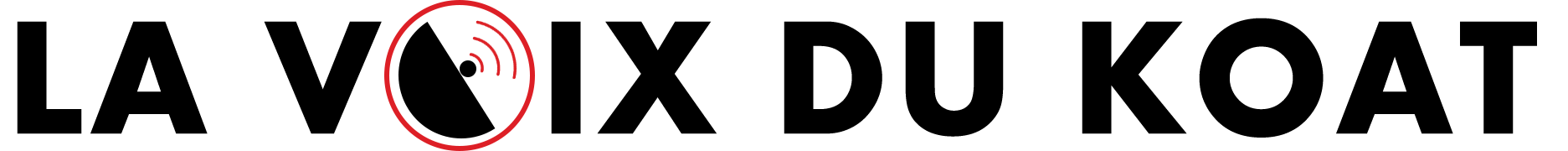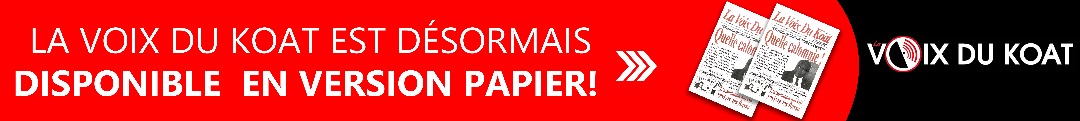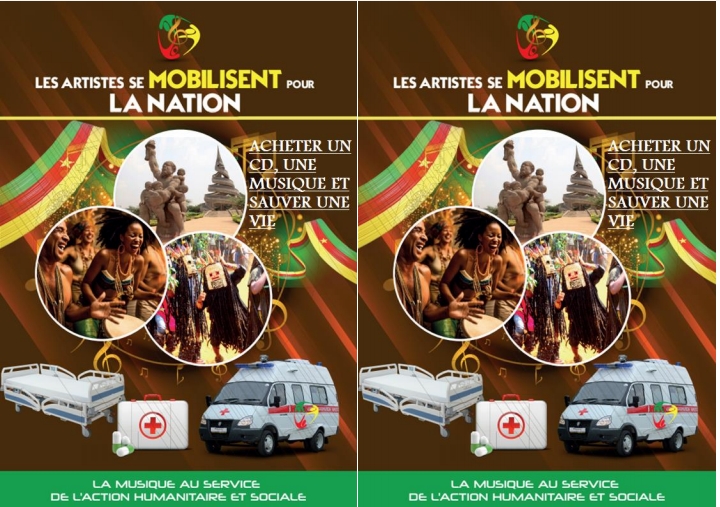Dans la précédente chronique, nous évoquions les lenteurs judiciaires au Cameroun, dont la conséquence la plus palpable est la surpopulation carcérale, avec une prédominance des détenus en attente de jugement. Les raisons de ces lenteurs sont nombreuses, de sorte qu’à tous les niveaux, les acteurs du système judiciaire exploitent chacun en ce qui le concerne, les failles existantes pour se dédouaner.

La première cause de cette lenteur est à chercher dans l’organisation judiciaire, qui n’est pas favorable à la célérité des procédures. A commencer par la souplesse dans les affectations des magistrats. D’après l’article 6 alinéa 1 du décret n° 95/ 048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature, « les nominations, mutations promotions, détachements, admission à un congé de maladie de longue durée, à la disposition ou à la retraite des magistrats sont décidés par décret. » S’appuyant sur cet article, le Président de la République procède ainsi à des déplacements fréquents de magistrats, parfois pour des raisons politiques ou disciplinaires, aggravant les lenteurs judiciaire et occasionnant souvent la disparition de certains dossiers. On assiste alors fréquemment à des renvois de procès pour affectation d’un magistrat, qui avait même jugé une affaire et mis en délibéré, mais que le nouveau doit reprendre à zéro. Ce qui parait normal, puisque dans le milieu on dit que pour trancher une affaire, le juge est seul devant le droit et sa conscience.
Sur un tout autre plan, l’absence d’autonomie budgétaire est une cause des lenteurs judiciaires. La justice doit par exemple, pour rémunérer le personnel ou acheter du matériel, attendre la dotation du ministère de la justice. Cette attente peut constituer un blocage dans le traitement des dossiers. Devant cette situation, certains magistrats qui veulent faire vite, peuvent demander au justiciable de supporter certains frais, ce qui est perçu dans l’opinion comme de la corruption, alors que dans le fond il n’en est rien. A cela s’ajoute l’insuffisance du personnel judiciaire. Une étude sur le système judiciaire au Cameroun indique qu’au sens quantitatif, les magistrats sont en sous-effectif dans l’ensemble. Cette étude constate que pour tout le Cameroun l’école de magistrature ne forme que vingt-cinq (25) magistrats tous les deux ans. Pourtant chaque année, il y a des décès et des retraités au sein du service public de la justice. Ce qui crée un vide que le recrutement tardif des nouveaux magistrats ne peut combler. On assiste alors à un engorgement du prétoire, et les magistrats en fonction sont parfois dépassés et préfèrent classer les dossiers sans suite.
Des témoins « téléguidés »
Dans le registre de ces causes, on ne peut pas faire abstraction de ce que les Ong et les organismes de défense de droits de l’homme appellent le laxisme des juges. Pour ces organisations, « le comportement du juge camerounais est empreint du laxisme habituel du fonctionnaire africain. Il peut décider de classer des affaires sans suite et sans motif sérieux, de faire traîner les affaires au préjudice d’un justiciable. Ce dernier acte est le fait des manœuvres dilatoires orchestrées par des justiciables plus nantis pour essouffler leurs adversaires. Ce déni de justice est le fait de certains juges, conscients de bénéficier d’une large protection ». Mais les lenteurs judiciaires au Cameroun ne se limitent pas au niveau des magistrats. Certaines lenteurs sont le fait des plaideurs, qui ne collaborent pas avec le juge. D’après Maître Youmbi du service juridique du Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine, ce sont des témoins « téléguidés » qui ne comparaissent pas, ce sont les avocats qui demandent le renvoi d’une affaire indéfiniment, ce sont les huissiers qui peine à exécuter les décisions de justice, ce sont les officiers de police judiciaire qui se donnent tout le temps pour une enquête.
À l’occasion de l’audience solennelle de rentrée de la haute juridiction il y a deux ans, le Premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe Sone s’est longuement attaqué à ce phénomène, pour finir par lancer un vibrant appel à l’endroit de ses collègues magistrats en ces termes : «A la fin de la journée, lorsque nous quittons le palais de Justice, nous devons toujours nous demander si un innocent ne croupit pas injustement en prison de notre fait. Nous devons nous demander si un citoyen n’a pas été injustement dépossédé de son bien de notre fait. Nous devons nous demander si un criminel n’a pas réussi à échapper aux mailles de la justice de notre fait. Nous devons nous demander si un orphelin ou une veuve ne maudit pas la justice par ses pleurs de notre fait. Nous devons nous demander si un investisseur n’a pas mis la clef sous le paillasson de notre fait. C’est de la sorte que nous pouvons réduire le risque d’erreur judiciaire». Quant aux victimes de ces lenteurs, ce ne sont pas seulement des personnes incarcérées sans jugement, mais aussi les personnes concernées par les affaires les plus courantes en justice. Cette situation déplorable provoque des inégalités de traitement des parties qui peuvent se permettre d’attendre plus longtemps un jugement. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre, ils préfèrent régler leurs affaires eux-mêmes. Ne pouvant pas attendre indéfiniment que la justice légale se prononce, ils se rendent eux même justice, avec des conséquences inimaginables.
Roland TSAPI, Journaliste