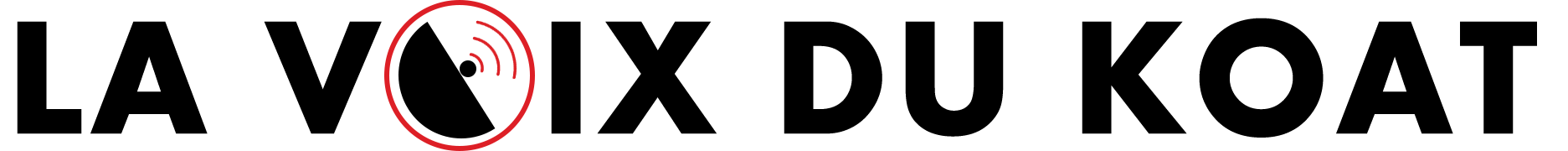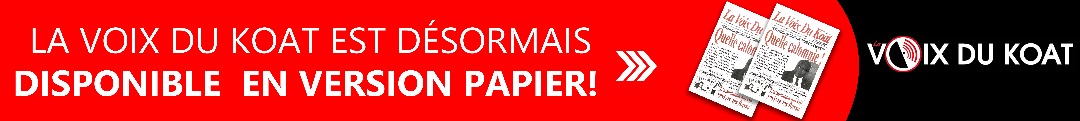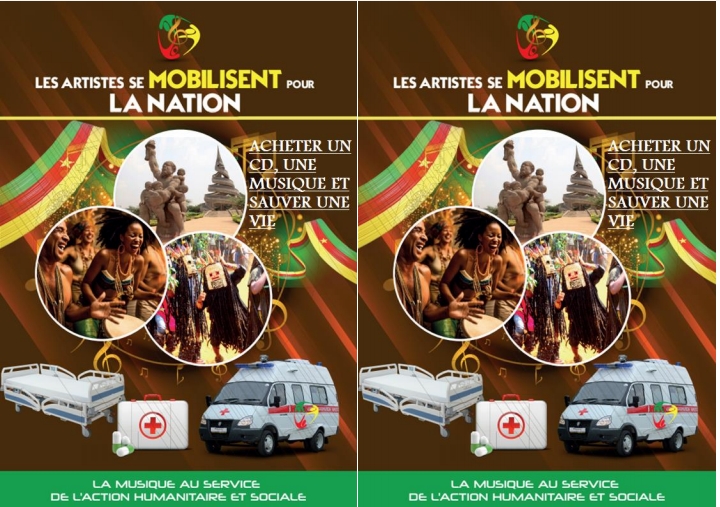Le gouvernement de Yaoundé et ses services déconcentrés n’entendent plus que le langage de la rue.

Le 29 mars 2017, une réunion d’urgence s’est tenue dans les services du Premier Ministre à Yaoundé, présidée par le Secrétaire général de cette institution, Séraphin Magloire Fouda. Elle avait pour objet la grève de certains enseignants du secondaire déclenchée deux jours plutôt pour réclamer leur prise en solde, autrement dit le début de payement de leur salaire, et l’apurement des arriérés de ces salaires cumulés jusqu’à 60 mois, d’après les écrits des pancartes qu’ils brandissaient devant les ministères à Yaoundé. Ces enseignants, estimés à plus de 20 000, sortis des Ecoles normales supérieurs quelques années plus tôt, se sont constitués en Collectif des enseignants indignés dont les représentants prenaient part à la réunion, en plus des ministres des Finances, de la Fonction publique, et des enseignements secondaires. Le communiqué final annonçait les mesures prises pour la résolution du problème, dont la principale est : « La prise en charge financière rapide et intégrale de l’ensemble des personnels enseignants concernés à compter du mois d’avril 2017».
Deux jours plus tard, Laurent Esso, ministre de la Justice Garde des sceaux, était face à la presse toujours à Yaoundé́, pour annoncer les mesures en cours d’élaboration visant à apaiser les avocats anglophones en grève depuis le mois d’octobre 2016, c’est-à-dire depuis 7 longs mois. Entouré de cinq de ses collègues ministres, dont l’incontournable Issa Tchiroma Bakari de la Communication, Laurent Esso a reconnu, et c’est là tout le sens de notre propos, que « courant octobre 2016, certains avocats anglophones sont descendus dans la rue des ressorts des Cours d’Appel du Nord-ouest et du Sud-ouest. A la suite de ces mouvements d’humeur, des revendications ont été exprimées relativement au fonctionnement de notre système judiciaire. » Ce sont là les propos du ministre lui-même.

Gouverner c’est prévoir
Des exemples de mouvements de grève qui secouent le Cameroun ces derniers temps peuvent être cités à souhait, mais nous nous arrêtons sur ces deux cas parce que justement ils ont poussé le gouvernement à sortir ces derniers jours pour annoncer des mesures, qui pouvaient pourtant être prises avant. D’où la question, qu’attendait-on ? Gouverner c’est prévoir, dit l’adage, mais si chaque fois le gouvernement, ou précisément ceux qui le composent doivent attendre que les populations sortent dans la rue pour réagir, cela donne l’impression que les décisions se prennent désormais dans cette rue là. Cela veut aussi dire que le centre des décisions, ou ce que les autres appellent pouvoir, a quitté les bureaux cossus et climatisés pour se retrouver dans l’austérité de la rue. Cela nous fait penser à l’inertie que le président Paul Biya lui-même avait dénoncé dans son gouvernement, sans pouvoir y changer grand-chose.
On en est arrivé là tout simplement parce que les fonctionnaires de l’État qui jouissent des privilèges, ont laissé tomber le manteau de l’écoute attentionnée, du courage et d’humilité, pour se vêtir de celui de l’arrogance, de mépris ignorant et d’égoïsme. Ainsi ils se comportent souvent comme s’ils étaient surpris de l’existence du problème posé, et d’autres poussent le mépris plus loin, au point de se montrer surpris que le problème soit posé, car d’après eux, ceux qui manifestent n’ont pas le droit de se plaindre, même s’ils sont lésés. Ils doivent souffrir et se taire, au risque d’être accusés de trouble à l’ordre public.
Le langage de la rue
Quand le Secrétaire général des services du Premier ministre dit dans son communiqué que c’est maintenant qu’une commission sera mise en place pour recenser tous les enseignants concernés, cela veut-il dire que jusqu’ici leur prise en solde n’était même pas à l’ordre du jour ? Cela nous amène simplement à comprendre que si les concernés n’étaient pas descendus dans la rue, leur problème n’aurait jamais trouvé de solution. Il en est de même pour les avocats anglophones et d’autres corps sociaux qui ne voient leurs problèmes trouver un début de solution, qu’après avoir manifesté, parfois bruyamment. Et quand nous parlons de début de solutions, c’est parce que de tous ces problèmes posés, aucune réponse concrète n’a été donnée. On en est encore aux promesses, qui ont au moins le mérite d’avoir calmé les mécontents, en tout cas pour l’instant. Cette façon d’agir est une preuve que le gouvernement de Yaoundé et ses services déconcentrés n’entendent plus que le langage de la rue.
Ils attendent que les populations leur forcent la main, crient au désespoir et parfois menacent de tout casser, avant de bouger. Et comme aucun secteur ne marche dans ce pays, et que le gouvernement n’a toujours pas intégré qu’il faut anticiper sur des solutions, il y a fort à craindre que cette habitude ne devienne contagieuse. Et qu’à l’approche de 2018 qui est une année électorale, tout le peuple ne se retrouve dans la rue. A ce moment là, personne ne peut présager de ce qui pourra arriver. Surtout que beaucoup risquent de se rappeler que les promesses faites il y a 7 ans lors de la campagne électorale présidentielle, n’ont pas encore été tenues.
Roland TSAPI, Journaliste.