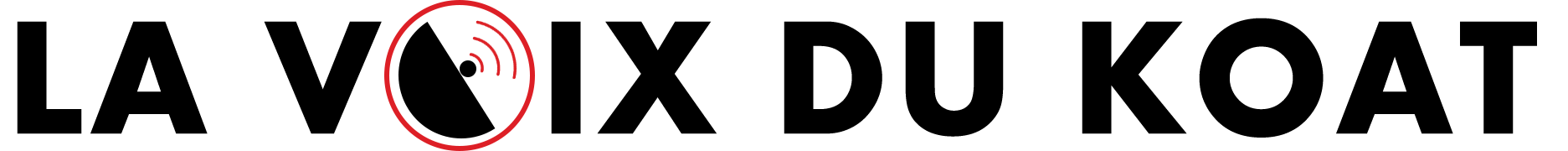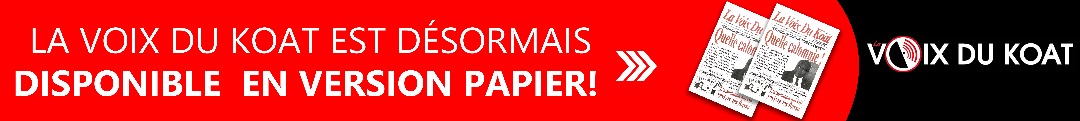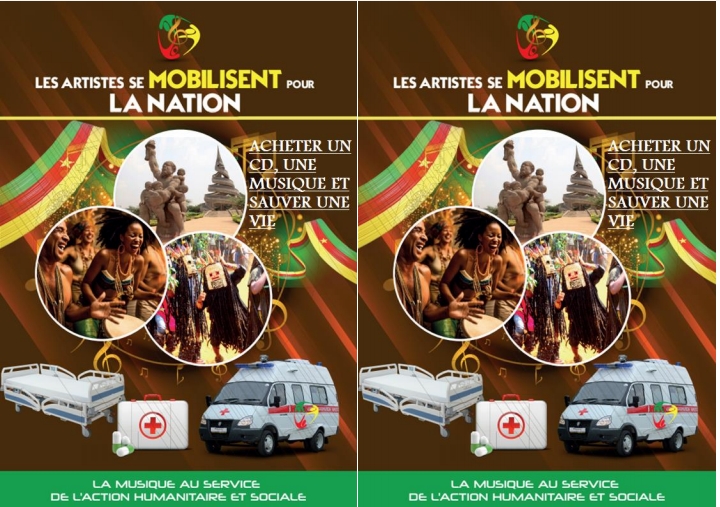Un incident s’est produit le 26 mai 2018 à Douala. En plein cœur de la capitale économique, le site devant abriter le monument Um Nyobe a été démoli par les chefs traditionnels du canton Bell. Dans sa mise au point formulé 24 heures après la survenue de cet incident, le canton Bell, du moins son représentant, précise que «le canton Njo Njo n’a jamais voulu faire du mal à la communauté Bassa ou le monument». Toute chose difficile à accréditer au sein des couches locales de la métropole économique. Mais au-delà de ce fait divers aux relents tribaux, des leçons méritent d’être retenues de cette passion identitaire.

La 1ère leçon à retenir de la démolition du chantier est liée à l’absence des consultations publiques nécessaires à la détermination du lieu où devait être érigé le monument de cette figure historique et emblématique. En effet, d’après le représentant du canton Njo Njo, «c’est avec stupéfaction que la population a constaté, un matin, des travaux de construction d’un monument en mémoire de Ruben Um Nyobe». En dépit des sollicitations plurielles faites à l’endroit du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala pour trouver l’avenue ou le carrefour, où ce monument devait être construit, Fritz Ntone Ntone n’a daigné y répondre favorablement. Toute chose ayant courroucé les populations autochtones enclines à se révolter contre la décision du premier magistrat de la ville et à exprimer leur aversion face à l’érection dudit monument. Ntone Ntone aurait pu, au gré des consultations populaires, identifier le site idoine pour l’implantation de cette bâtisse symbolique sans susciter des cas de frustration et de vives controverses à l’image de l’indicateur de l’incident survenu le 26 mai 2018 à Douala. En même temps, faut-il se faire justice dans une République? Que nenni!
Une guérilla urbaine et un affront avec le peuple Sawa
La 2ème leçon de cet acte est relative au fait que toute communauté -fût-elle petite ou grande, riche ou pauvre- ne se fait pas justice dans un Etat réglementé, structuré, organisé et hiérarchisé. En ce sens, l’acte commis par les chefs traditionnels du canton Bell est une déviance, mieux une excroissance ethno-régionale, laquelle fait resurgir la rémanence des pulsions et émotions identitaires. C’est non sans pertinence que l’acte de cette élite traditionnelle est appréhendé comme un acte de vandalisme.

La 3ème leçon née de cette scorie ethniciste, voire communautariste se rapporte à la nécessité, pour tout peuple, de savoir mesurer les conséquences des actes produits. En effet, en optant pour la méthode populiste et anachronique dans le sens de la démolition du site devant abriter la stèle d’Um Nyobe, la communauté traditionnelle Sawa heurte et offusque la sensibilité de la communauté Bassa au point d’engendrer la conflictualisation des rapports entre ces deux aires tribales chères à l’agglomération Douala. N’eût été, par exemple, l’intervention de certains médiateurs sociaux (leaders d’opinion) pour tempérer les ardeurs et les dissensions intercommunautaires qui couvaient sous le feu de la destruction du site, la communauté Bassa de Kongmondo aurait, sans conteste, créé une guérilla urbaine et un affront avec le peuple Sawa. Une marche était, d’ailleurs, prévue dans ce sens, le point de chute étant l’activation d’une sorte de revanche belliciste, dont la cible était les Sawa. Heureusement, cette idée a été étouffée pour ne pas basculer, personne ne le souhaite, dans une guerre civile. Cette 3ème leçon incline, sans fards, à déboucher sur la 4ème, à savoir qu’il est interdit de provoquer la tribu hospitalière.
En réalité, l’histoire nous renseigne que Douala (Dihala, Duala, Diala), cité portuaire et cosmopolite, aujourd’hui investie par diverses peuplades, avait, originellement, été occupé par le peuple Bassa avant l’arrivée des explorateurs. Le peuple Bassa disposait alors de trois régences placées sous l’égide de trois grandes chefferies dans la contrée Babimbi. Il s’agit, en l’occurrence, des régences de Bonaberi, de Deido et de Ndogbong. Il faut alors attendre plusieurs siècles pour que les Ngala-duala, en provenance du Congo, de la Sierra-Léone et du Ghana y rejoignirent ceux qui seraient vraisemblablement leurs cousins, à l’instar des Bassa. A la suite des échauffourées opposant les allogènes aux autochtones, le chef de la localité Bassa se décida à transférer les allogènes en amont de la côte, afin d’être mieux contrôlés. Voilà donc comment les Ngala-duala bénéficièrent officiellement d’une dotation de deux domaines en plein cœur de ce qui allait devenir la ville de Douala. Il s’agit, pour le premier espace, de la rivière de Mboppi à Deido en touchant Akwa-Bonakou (actuel Bessengue). Quant au second espace, il était Djebalè (Di é balè), ce qui signifie «ce qui nous a été donné».

Des acteurs et des traîtres
Autant les 3ème et 4ème leçons sont corrélées, autant les 4ème et 5ème sont indissociables. Le dernier enseignement invite les Scientifiques à réécrire l’histoire. En fait, si l’histoire, longtemps biaisée et galvaudée par des intellectuels organiques militants, était bien écrite et transcrite par de meilleurs théoriciens apurés des oripeaux idéologiques, quiconque ne s’aventurerait pas à commettre de basses besognes. Une communauté culturelle donnée ne basculerait pas dans des errements et désagréments de l’acabit expérimenté dans la capitale économique. Au lieu donc de s’agglutiner autour d’un pseudo débat lié à l’antinomie des figures emblématiques et historiques ayant contribué à la construction de la société politique camerounaise depuis la période coloniale, les indépendances et la période post-indépendante, il vaut mieux savoir qu’entre les martyrs ayant combattu contre les puissances colonisatrices, il y avait eu des vainqueurs et des collaborateurs, il y avait eu des acteurs et des traîtres, il y avait eu des héros et zéros. Pour parler prosaïquement, entre Rudolph Duala Manga Bell -qui, le 18 juillet 1884, participa activement à la cérémonie de prise de possession du territoire camerounais au profit des Allemands- et Ruben Um Nyobe, Félix Roland Moumie, Ernest Ouandie, Abel Kingue, Ossende Afana, Yem Mback, Madola, Mbombo Njoya, Martin Paul Samba, Charles Atangana (dont certains se sacrifièrent au prix de leurs vies, en réparant le forfait commis par Bell, Akwa et Cie), qui sont de véritables héros nationaux? Ne nous voilons pas les yeux! Nous savons qui est héros national et qui ne l’est pas. Ne biaisons pas les faits! La nécessité de la réécriture de l’histoire du Cameroun se pose avec acuité et s’impose de toute urgence.
Serge Aimé BIKOI, Journaliste et Sociologue du développement