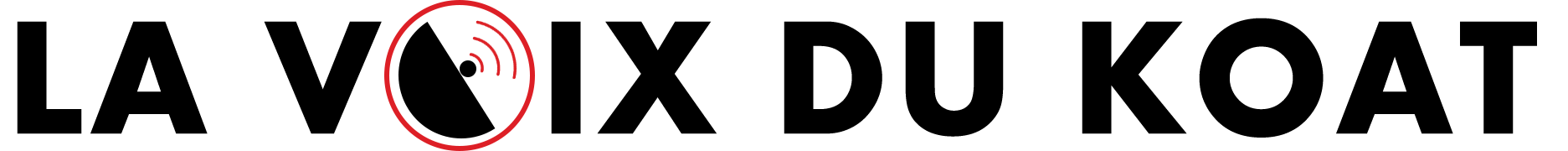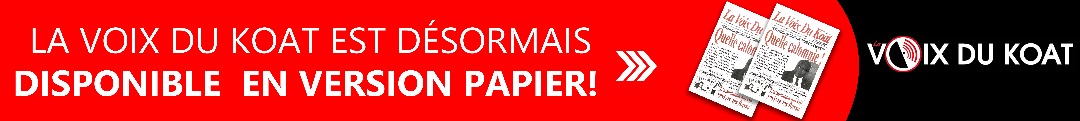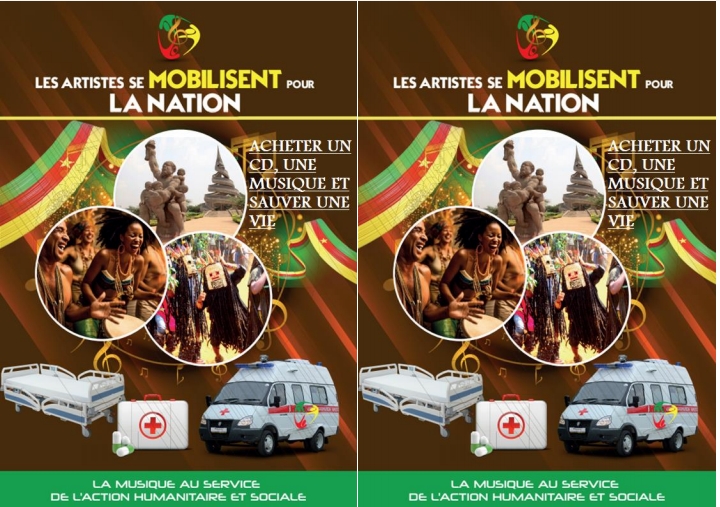L’ouvrage intitulé «Désordre urbain et plaidoyer et insécurité au Cameroun ; évaluation et plaidoyer pour une gouvernance urbaine rationnelle» est une analyse froide du phénomène, de ses visages, de ses mobiles ainsi que ses diverses conséquences alors même que le pays se dit engagé dans une quête effrénée de l’émergence.

Le sujet, pour préoccupant qu’il est, méritait qu’on s’y attarde. Et celui qui a choisi d’en parler, en a toute l’autorité et la légitimité. Spécialiste des questions urbaines, membre de l’Association américaine de sciences politiques (Apsa) et du Groupe de recherche sur les dynamiques sociales et politiques (Gredysop), André Tassou, dans cet ouvrage dense de 330 pages, fait une espèce d’autopsie du processus d’urbanisation en Afrique sub-saharienne et principalement au Cameroun où la responsabilité, la transparence, l’état de droit et la participation aux affaires publiques ont foutu le camp de la gouvernance urbaine. Plus d’un demi-siècle après les indépendances, remarque l’expert, les villes africaines en général et camerounaises en particulier peinent à emprunter l’itinéraire de la gestion rationnelle de l’espace urbain. Une seule expression les caractérise : le désordre urbain.
Tout commence par les plans d’urbanisation. Si certaines de nos villes en ont un, il est sagement resté dans les tiroirs. Les citadins n’en ont aucune idée et les autorités municipales ne font rien pour le mettre à la disposition des citoyens. Les mairies n’aménagent pas le lotissement urbain ; cette tâche est abandonnée à la liberté des propriétaires terriens qui peuvent, s’ils le veulent, lotir leur parcelle ou non. Lorsque ceux qui le veulent le font, certains acheteurs vont parfois jusqu’à ronger les espaces laissés pour les servitudes, de sorte qu’à la fin, tout se passe comme si rien n’avait été prévu. De nombreux propriétaires ne prennent même pas cette précaution, mettant en vente le moindre espace pour engranger le plus d’argent possible. Il y a donc un processus de « bidonvilisation » des cités camerounaises. Pire, les terrains privés de l’Etat sont occupés par les particuliers qui réussissent même l’exploit d’y obtenir des titres fonciers. Tout ce désordre s’organise à la barbe des autorités. De temps en temps, lorsque l’Etat veut viabiliser un bidonville, agrandir une route, la mairie se livre alors à des destructions de maisons et informe à l’occasion, soit que l’espace appartenait à l’Etat, soit que le plan d’urbanisation prévoyait autre chose à cet endroit. Lire aussi :Inondation : Le produit de l’incivisme des populations
Promotion d’une politique de la ville
Vecteur du sentiment d’insécurité, l’espace public représente un défi majeur pour la gestion urbaine et la sécurité de proximité. Auparavant, la sécurité urbaine s’affirmait comme un enjeu politique majeur. Mais face à la dépravation progressive des mœurs, à la montée de la criminalité et aux violences urbaines, « les pouvoirs publics camerounais essaient de répondre par la promotion d’une politique de la ville. Celle-ci est fondée sur une approche essentiellement sociale dont l’objectif global est loin d’être la réduction de l’insécurité urbaine », écrit-il. Les violences urbaines sont perçues au Cameroun sous plusieurs formes. Elles sont à l’origine de l’insécurité urbaine qui sévit quotidiennement au sein des populations urbaines. Au rang des plus perceptibles au niveau de l’espace public, figurent en bonne place les provocations et les injures verbales, les agressions physiques de tous les ordres, les rackets, les dépouilles, les rixes entres les bandes, les attaques des commissariats et autres bâtiments publics, les les pillages divers.
Démission des pouvoirs publics
Chacun agit comme bon lui semble, sans peur, ni inquiétude, eu égard à la démission des pouvoirs publics de certaines de leurs fonctions régaliennes. En guise d’exemple, l’auteur énumère la préservation de l’ordre public, la protection des citoyens camerounais et de leurs biens, la préservation de l’ordre public et la protection. Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Buea, Douala, Ebolowa, Garoua, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé sont mis en index.
Daniel NDING