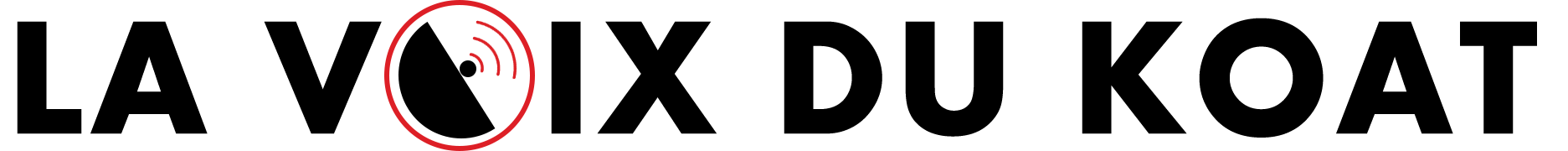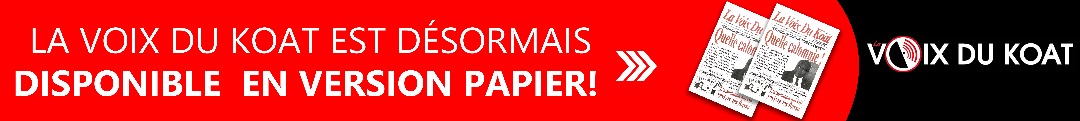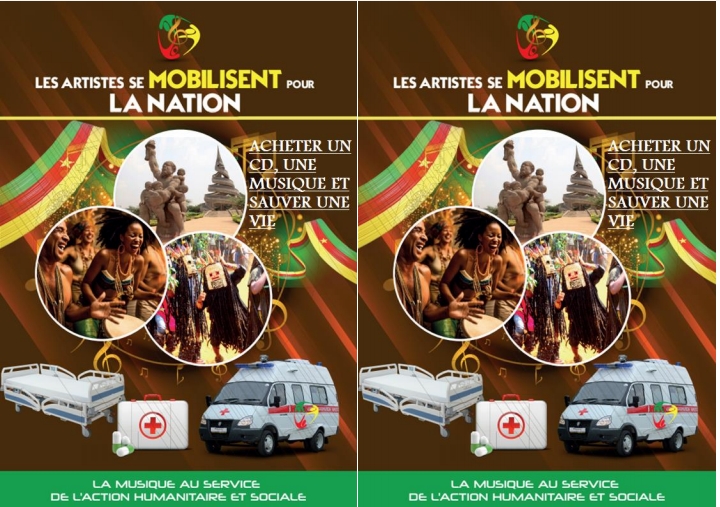Jusqu’en 1995, les Camerounais désireux d’avoir une ligne téléphonique étaient à la merci de l’entreprise Camtel, seule opératrice sur le marché. Mais l’arrivée des opérateurs mobiles l’ont mise à l’étroit, l’entreprise s’est rendue compte qu’elle n’était plus indispensable. Les nouvelles sociétés qui se sont implantées ont utilisé des méthodes de gestion moderne, basées sur l’atteinte des objectifs, loin du fonctionnariat qui avait perpétué au sein de l’entreprise parapublique, la bureaucratie, des lourdeurs administratives et la recherche du profit personnel au détriment de l’expansion de l’entreprise.
A cette époque, la demande d’une ligne téléphonique pouvait mettre 6 mois avant d’aboutir, après même que les clients fassent le pied de grue dans divers bureaux pour voir le dossier avancer. Aujourd’hui, la composition du dossier est non seulement allégée, mais une fois déposée, le client a une semaine, calendrier en main pour se voir installée. C’est vrai que des manquements subsistent dans le service après-vente, mais il faut reconnaître que l’entreprise fait des efforts pour soigner son image et entretenir sa clientèle, même si elle reste larguée dans ce domaine. En tout cas le client de Camtel est aujourd’hui relativement mieux traité qu’il y a 20 ans, et ce grâce à la concurrence. Cette concurrence, c’est ce qui manque encore dans le secteur de l’électricité, de l’eau et de l’hygiène publique. Dans chacun de ces secteurs, le prestataire reste unique au Cameroun, pourtant la libéralisation est prévue dans les textes depuis longtemps.
Lire aussi :Services de base au Cameroun : le danger du monopole (1)
Électricité, personne ne s’en approche
Pour l’électricité, depuis la promulgation de la loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité au Cameroun, tout opérateur économique qui le souhaite peut produire l’électricité et le vendre, à conditions bien entendu de souscrire aux règles qui encadrent le secteur. Il suffit d’après l’article 29 par exemple d’obtenir une licence soit pour la production indépendante d’électricité, soit pour la vente de l’électricité de très haute, haute et moyenne tension, soit pour l’importation et l’exportation de cette l’électricité.

Les articles 30 et suivants expliquent davantage en quoi consistent ces activités : les producteurs indépendants d’électricité assurent la production et la vente d’électricité aux distributeurs ou aux grands comptes, les exportateurs peuvent récupérer l’électricité excédant les besoins du marché intérieur, qui devient libre de destination et de revente à l’étranger aux conditions les plus favorables, dans le respect des engagements internationaux de la République du Cameroun.
Les conditions sont par ailleurs plus souples en zone rurale. Selon l’article 60 : « Dans le cadre de l’électrification rurale, et dans les limites définies par voie règlementaire, la production, notamment de centrales hydroélectriques de puissance inférieure ou égale à 5MW, la distribution et la vente d’électricité sont assurées par simple autorisation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sans exigence particulière d’appel d’offres, de publicité, dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment les règles de sécurité et de protection de l’environnement.» Mais à ce jour, aucun opérateur privé ne s’est aventuré dans ce domaine. Seule l’entreprise étatique a longtemps assuré le service, avant d’être privatisé à la faveur de l’ajustement structurel des années 90. La Sonel est ainsi devenue d’abord Aes Sonel et puis Eneo aujourd’hui, et l’une des conséquences directe du monopole du secteur est que dès la privatisation en 2004, le prix du kilowatt avait subi 3 hausses en quatre ans, au même moment où les Camerounais s’habituaient au nouveau mot : le délestage.
Eau, risque de noyade ?
Dans le domaine de l’eau, le Décret n° 2001/164/PM du 08 mai 2001 précisant les modalités et conditions de prélèvement des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales, a été signé il y a 18 ans par le premier ministre Peter Mafany Musonge à l’époque. D’après l’article 5, « Toute personne désirant implanter et/ou exploiter une installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant le prélèvement des eaux de surface ou souterraines à des fins industrielles ou commerciales, adresse une demande d’autorisation au Ministre chargé de l’eau.» Mais jusqu’à présent, ceux qui ont montré un peu d’intérêt pour le secteur opèrent dans un couloir complètement différent de celui de la distribution d’eau potable dans les ménages, ils s’intéressent plutôt au conditionnement et à la vente, en sachet, bouteilles ou bonbonnes.
Dans les zones rurales, certaines localités ont connu dans les années 80 le projet Scanwater, qui avait permis de construire 350 stations d’eau à travers le pays, et de nombreux projets d’approvisionnement et d’assainissement continuent de se mettre en place dans certains villages, mais rien à voir avec la grande distribution comme c’est le cas pour la Cameroon water utility, Camwater. Ici aussi, la conséquence du monopole est non seulement la non-fourniture continue de l’eau, mais l’imposition d’une pénalité de retard de paiement des factures de plus de 4000 Fcfa, même si le montant de la facture est de 1500F pour prendre un exemple.
Climat des affaires hostile
Que dire de la société de ramassage des ordures ? Plusieurs fois annoncée, la concurrence dans ce secteur peine à s’installer, et en attendant, les Camerounais continuent de subir le diktat des opérateurs dont le monopole fait d’eux, chacun dans son domaine, les seuls à imposer leur lois. Les secteurs suscités sont pourtant très porteurs d’après les études de rentabilité, mais les investisseurs estiment que l’environnement camerounais reste très hostile pour les affaires, et les différentes crises qui secouent le pays en ce moment n’arrangent pas non plus les choses. L’Etat se retrouve là, une fois de plus, une fois encore, interpellé quant à l’assainissement du climat des affaires. Ce qui aura pour effet d’attirer davantage d’investisseurs qui installeraient la concurrence, laquelle impose automatiquement l’amélioration du service, pour le bien tout le monde.
Roland TSAPI