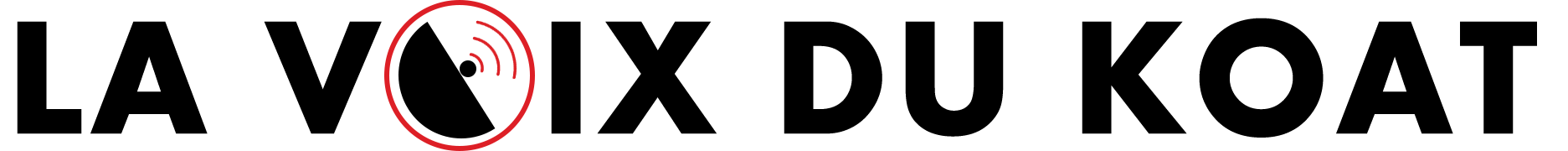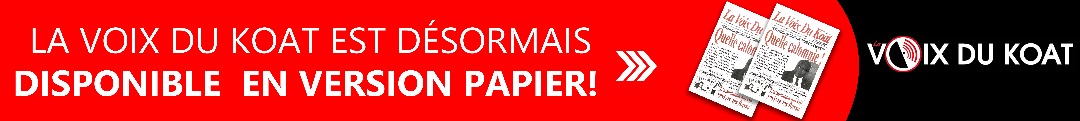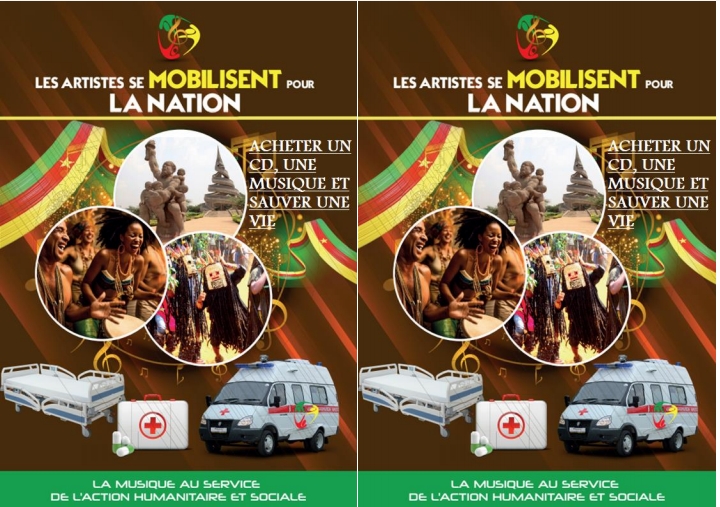Le fonctionnement du système gouvernant donne souvent l’impression d’être grippé. C’est ce que le président Biya a appelé absence de cohésion ou solidarité gouvernementale. Qui se caractérise par le refus délibéré d’une administration de faciliter le travail d’une autre, pourtant toutes prétendent servir le même régime. Dans le champ des droits de l’homme, les gouvernants ne tarissent pas de vocabulaire pour démontrer que le Cameroun n’a rien à se rapprocher en a matière, chaque fois que des cas de violations sont relevés de l’intérieur comme de l’extérieur. Pourtant, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDHL), une création du Président Biya lui-même, éprouve de la peine à travailler dans les prisons dirigées par les régisseurs eux aussi nommés par le même président.
La Commission des droits sans droit
Le 11 mai 2018, le journal l’œil du Sahel faisait état d’une information révélée par Chemuta Divine Banda, le président de cette commission au cours des travaux de leur 24e session. D’après lui, la Commission s’était heurtée au refus des autorités, alors qu’elle avait manifesté sa volonté d’accéder aux pénitenciers de Yaoundé. Le 22 mars 2019, cette commission est allée plus loin en rendant publique une lettre ouverte au président de la République au sujet de la crise anglophone. Elle laissait entendre dans cette lettre que « certaines personnes profitent de la crise qui pourtant engendre des dommages incommensurables à l’ensemble des populations », et prévenait que la situation « pourrait empirer si des mesures conséquentes et urgentes ne sont pas prises pour inverser la tendance. »
En rappel, la loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, dit en son article 2: « La Commission diligente toutes enquêtes et procède à toutes investigations nécessaires sur les cas de violation des droits de l’homme et des libertés et en fait rapport au Président de la République, procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d’un rapport adressé aux autorités compétentes. » C’est dire qu’en allant en prison voir la situation des pénitenciers, elle était dans son rôle. Mais cela n’a pas empêché à ceux qu’on peut appeler ses collègues de décret de lui fermer les portes, alors qu’il venait regarder l’intérieur de la prison pour faire son rapport au Président de la République comme l’exige le décret de création.
Et les responsables des prisons ne semblent pas être les seuls à mettre les bâtons dans les roues de la Cndhl. Dans la lettre ouverte, Divine Chemuta Banda rappelle qu’elle a régulièrement adressé au président des rapports assortis des recommandations, et évoque à titre d’exemple ceux du 9 février 2017, 18 juin 2018, 14 janvier 2019 et 18 février 2019. Et d’expliquer :« Excellence, c’est parce que la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés n’a jusqu’ici reçu aucune réaction suite à ces différentes correspondances qu’elle a opté pour une approche directe à travers cette lettre ouverte. »
En d’autres termes, le président de la Commission disait au président de la République, que soit une administration autour de lui bloquait ses rapports dans des tiroirs et ils ne lui parvenaient jamais, soit ils lui parvenaient mais lui-même constituait le blocage en ne réagissant jamais, dans ce cas elle n’avait plus de choix que de prendre l’opinion nationale et internationale à témoin, en procédant par la méthode de la lettre ouverte. Dans l’un ou l’autre cas, il est évident que le système joue contre lui-même, en tirant des balles dans ses propres pieds. A quelle fin ? Difficile de savoir, toujours est-il que cette pratique empêche la machine administrative de tourner en rond et apporter des solutions en temps réel.
La Conac aussi
La Commission nationale des Droits de l’homme n’est pas la seule à souffrir de cette situation. En janvier 2017, l’ex-président de la Commission nationale anticorruption, le Professeur François Anoukaha, au cours de la cérémonie de présentation officielle du Rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2015, déplorait le manque de collaboration de 11 départements ministériels dans la lutte contre la corruption. Il citait les ministères de l’Administration territoriale, de la Défense, des Finances, de l’Agriculture, des Relations extérieures, des Domaines, cadastres et affaires foncières, des Mines, des Transports, des Sports et Education physique, des Affaires sociales et enfin de la Communication. François Anoukaha s’indignait enfin en ces termes :« Cet état des choses déplorable tient tantôt à l’inexistence formelle des Cellules de Lutte contre la Corruption dans ces Institutions, tantôt à leur léthargie là où elles existent. Il convient de rappeler que la lutte contre la corruption n’est pas facultative. Il s’agit d’un engagement fort du Chef de l’Etat et par conséquent, les différents segments de la société camerounaise tout entière sont chargés de son implémentation. »
Le décret

On a souvent cité aussi des cas où un commissaire de police refuse de sortir de sa cellule un prévenu sur ordre d’un Procureur de la République, on a connu des unités de commissariat ou de gendarmerie où les adjoints n’obéissent pas aux patrons des lieux sous prétexte qu’ils sont tous deux nommés par décret et par la même personne, le président de la République. On a connu des cas où des maires et délégués du gouvernement refusent d’appliquer des instructions des préfets, des décisions de justice ou de l’inspection du travail et n’en font qu’à leur tête, car bénéficiant d’un décret de nomination comme les autres.
Mais il faut le dire, l’absence de la solidarité gouvernementale tient du fait d’une forte centralisation du pouvoir du décret sur le président de la République, et chacun qui en bénéficie le considère comme un don de Dieu, une affaire personnelle. Collaborer avec les autres membres de l’administration n’est dès lors pas une préoccupation essentielle, chacun évolue dans son couloir et protège ses arrières.Tant pis pour la fluidité et la complémentarité de l’administration, tant pis pour la continuité du service, tant pis pour le rendement et l’efficacité, qui d’ailleurs ne sont pas des critères déterminants pour la prochaine… nomination.
Roland TSAPI