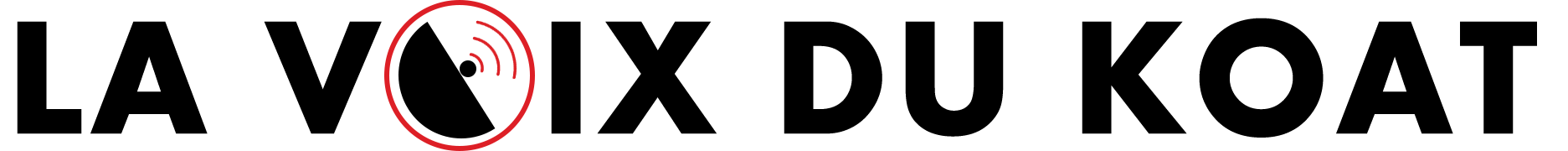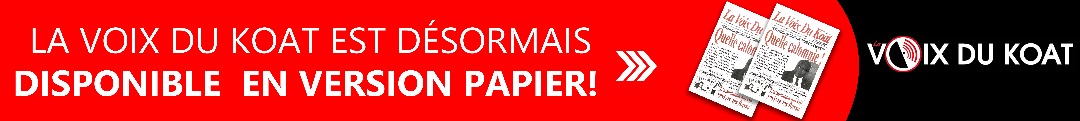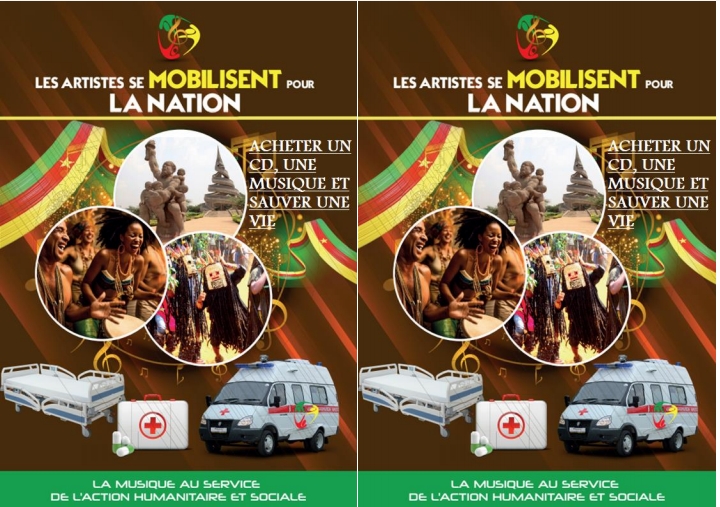L’histoire des élections présidentielles est rythmée comme nous l’avons dit précédemment par des coalitions des partis politiques de l’opposition dans le but de vaincre le parti au pouvoir. Des coalitions faites sous différentes formes mais qui ont toujours connu le même sort, l’éclatement à la dernière minute suivie de l’échec. Ce qui fait sourire certains quand on parle de coalition de l’opposition aujourd’hui en vue de l’élection du 7 octobre. Les militants du parti au pouvoir s’en moquent dans les médias, y perçoivent les germes de l’auto destruction. Mais la société civile croit dur comme fer qu’elle est désormais possible. Les partis politiques en lice aussi, et même ceux qui ne le sont pas.
Les causes de l’échec permanant
D’après les analystes, deux causes principales ont été à l’origine des échecs successifs du Directoire, de la Coordination, de l’Union pour le changement en 1992, et de la Coalition pour la réconciliation et la reconstruction du Cameroun Cn2r en 2004. Il s’agit des manœuvres fractionnistes du pouvoir et de l’égo personnel des leaders d’abord. S’agissant des manœuvres du pouvoir, il est aujourd’hui établi que beaucoup de membres du Directoire et de la Coordination en 1992 sont devenus au moment de l’élection les membres de ce qui a été appelé la majorité présidentielle, parce que leur rôle dans le Directoire ou la Coordination était d’empêcher que ces instances n’atteignent leurs objectifs.

Un acteur de l’époque raconte que l’une des premières réunions du Directoire est tenue au foyer de la jeunesse protestante à Douala, puisqu’il fallait trouver des espaces assez neutres pour les tenir, il y a des leaders des partis politiques qui sont sortis furtivement pour aller téléphoner à Yaoundé. A partir de là, aucune réunion du Directoire et de la Coordination ne pouvait se tenir sans qu’il y ait des problèmes de sécurité, la police pour intervenir ou autres perturbations de toutes sortes. Parce que le pouvoir était régulièrement informé de ce qui allait se passer. De même, quelques temps avant l’élection, nous sommes toujours en 1992, un membre de la Coordination s’est fait interviewer à la Crtv le plus officiellement du monde, pour dévoiler le plan de la marche que l’opposition avait prévu dans la capitale. Du coup, lorsque cette marche a été engagée, elle n’a pas été interdite, mais a tout simplement été déviée pour devenir pratiquement inutile et invisible. Cette infiltration de l’opposition était en partie due au foisonnement des partis qui composaient les différents mouvements, et malgré la dizaine de partis qui se sont réunis autour de l’Union pour le Changement de dernière minute en 92, il en est resté assez nombreux pour présenter des candidats au final. Pareil en 2004 quand malgré la Cn2r, 16 candidats se sont retrouvés dans les urnes.
Pour ce qui est de l’égo personnel, à chaque fois dans le passé, les principaux acteurs semblaient dire « oui pour la coalition, à condition que ce soit mois qui la conduise. » Cela a été le cas surtout en 2004 quand John Fru a estimé après le choix porté sur Adamou Ndam Njoya pour conduire la coalition, qu’il avait le plus grand parti et que ce sont les autres qui devaient s’aligner derrière lui et non le contraire, car disait-t-il, c’est le fleuve qui va vers l’océan et non l’inverse.
Prendre en compte la nouvelle donne politique

Mais aujourd’hui il y a des raisons de croire, et c’est sur ces raisons que s’appuient les pourfendeurs d’une coalition solide aux premiers rangs desquelles la société civile. La première raison pour laquelle l’optimisme règne, c’est que l’égo personnel est assez relativisé, malgré certaines déclarations qui tendent à ramener tout rassemblement autour de soi. Aussi, contrairement à ce qui s’observait dans le passé, les leaders des partis, malgré leurs divergences peuvent se parler autrement que comme des ennemis, et cela est très important dans le processus de mise ensemble. L’évolution de la société est à prendre en compte. Le peuple est prêt à rejeter tout candidat qui refuserait délibérément de participer à une coalition, en faisant prévaloir une raison quelconque, surtout qui mette en avant ses intérêts, sans négliger le fait que les jeunes sont entrés en compte. Ce qui commençait à disparaitre au Cameroun, et ilstiennent à faire entendre leurs voix et à marquer de leur emprunte l’histoire politique. La deuxième raison de croire, c’est que jusqu’à présent le nombre de candidats, 8 jusqu’ici en dehors de celui au pouvoir, est maitrisable. On est très loin de la flopée des candidatures comptées en 92 et 2004, ce qui réduit les chances de fuites d’informations et de retournement.
En plus l’intelligence politique a évolué dans l’opposition. La notion de grand parti jadis évoquée est révolue. L’encrage politique n’est plus nécessairement déterminée par une représentation dans les institutions, la sympathie populaire envers certain candidats va au-delà des appareils politique. L’une des raisons non moins négligeables enfin, est qu’il y a parmi les candidats de l’opposition certain qui sont prêts à faire un mandat non pas de 7 mais de 3 ans, le temps de nettoyer les textes et remettre tout le monde sur la ligne de départ avec les chances égales. Jusqu’ici des rencontres sont annoncées, des correspondances circulent, les coups de téléphone sont passés. Les candidats donnent l’impression d’avoir compris l’enjeu et pendant qu’ils s’activent, le peuple lui, comme les évêques en conclave à Rome, attendent impatiemment la fumée, en espérant qu’elle sorte blanche.
Roland TSAPI