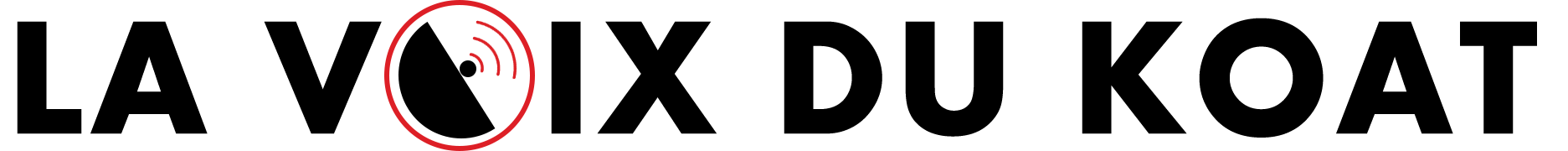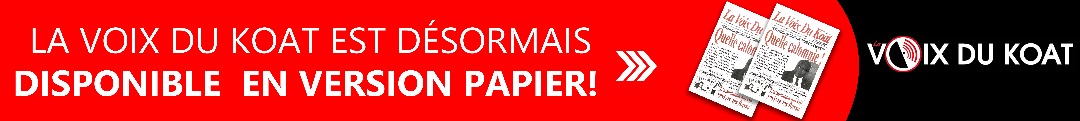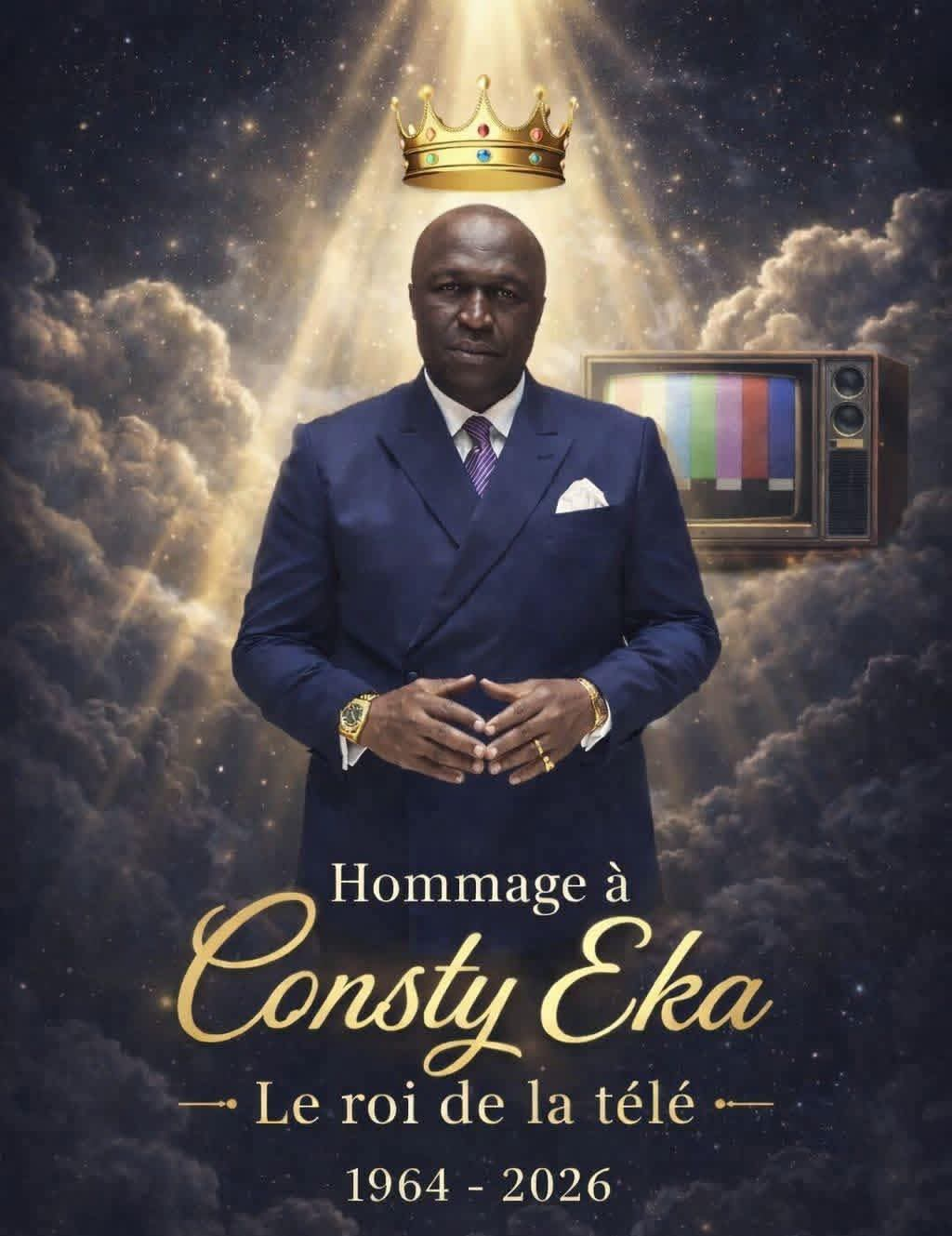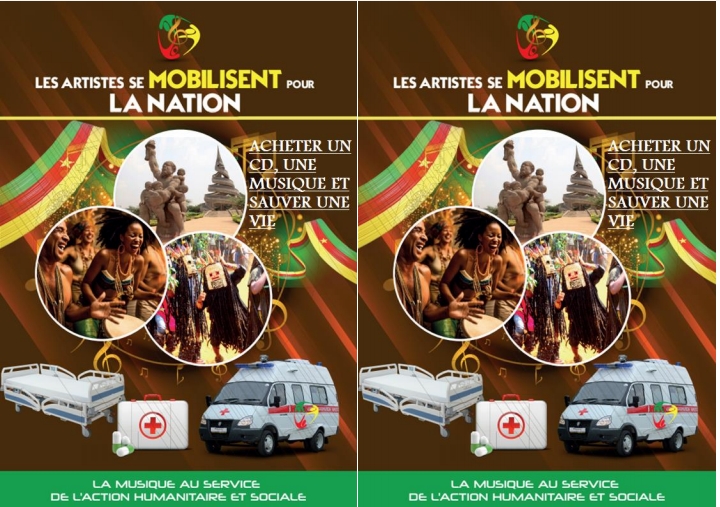À Dibombari, une vidéo virale a ravivé les blessures et les rancunes autour de la Socapalm. Mais après enquête, la supposée victime nuance ses propos et accuse la manipulation de ses propos.
Depuis plusieurs mois, une vidéo d’une tranche de 18 minutes, réalisée par la Synergie Nationale des Paysans et riverains du Cameroun (Synaparcam) et diffusée sur les réseaux sociaux suscite indignation et débat autour de la Socapalm à Dibombari. On y voit une femme, identifiée comme Mme Agnès Soppo Epse Dipanda en pleurs, affirmant avoir subi une agression sexuelle commise, selon ses termes, par des membres des Comités de Vigilance Villageoise (CVV). Les images ont bouleversé l’opinion et nourri la perception d’un climat d’abus, d’impunité et de brutalité au sein des plantations.
Lire aussi : Dibombari : ce creuset du patrimoine camerounais
Face à cette onde de choc, une mission d’enquête initiée par notre rédaction a été dépêchée le 7 novembre 2025 dans les villages riverains afin de confronter le récit médiatique aux faits : témoignages directs, recoupement d’informations, état des procédures, version des autorités traditionnelles et position des responsables locaux. Ce déplacement révèle une réalité plus complexe que celle présentée en ligne : des tensions existent, des attentes sont réelles, mais plusieurs affirmations clés de la vidéo ne résistent pas à la vérification.
Lire aussi :Apouh : entre droit et désinformation, la Socapalm rétablit le cadre légal
Dans la vidéo largement partagée, dame Soppo déclare avoir été agressée par des membres des CVV, que le Synaparcam présente comme les bras armés de la Socapalm. Une bien grave accusation dont la version suggère l’existence d’un système organisé de violences, impliquant directement la société. Pourtant, aucune plainte n’a été déposée ni auprès de la gendarmerie, ni auprès des responsables locaux. De même, aucune trace administrative, médicale, disciplinaire ou judiciaire n’existe à ce sujet.
Selon plusieurs sources concordantes, l’affaire aurait été réglée de manière informelle, sans que ni l’entreprise ni les forces de l’ordre n’en soient saisies. Dans un cas aussi grave que des violences sexuelles, l’absence de plainte empêche toute enquête légale, interne ou disciplinaire. C’est là un premier élément majeur qui contredit l’idée d’un système organisé ou toléré.
Sur le terrain, le reporter a rencontré M. Dipanda Manfred, époux de la victime présumée. Son témoignage, précis et direct, apporte un éclairage décisif : « L’agresseur n’était pas un membre des CVV. C’était un contractuel d’un sous-traitant », précise-t-il. Autrement dit, l’individu mis en cause ne dépendait ni de la sécurité interne de la Socapalm, ni des brigades villageoises incriminées dans la vidéo. Cette confusion entre « CVV » et « contractuel » modifie profondément la portée de l’accusation.
Le même témoin reconnaît par ailleurs que l’entreprise n’a jamais été alertée, qu’aucune plainte n’a été déposée et qu’une tentative de règlement informel aurait été entreprise au village avant la disparition de l’individu impliqué. Dès lors, l’entreprise ne pouvait ni enquêter, ni sanctionner, ni apporter assistance à la victime. Ces éléments contredisent la version d’une agression commise par des agents identifiables et protégés par la Société.
Le démenti des CVV
Rencontrés le même jour, les responsables de sécurité de la plantation et les équipes des CVV affirment n’avoir reçu aucun signalement ni plainte concernant un incident de cette nature. À Mbonjo 2, M. Valentin Epoh Epoh, responsable des opérations CVV exprime sa désolation face à de telles affirmations. « Je suis surpris de voir ce type de vidéo. Le CVV ne peut pas violer quelqu’un. Aucun incident ne nous a été rapporté. »
Pour lui, la mise en cause des CVV relève d’une confusion ou d’une exagération. Les faits, faute de signalement officiel, demeurent invérifiables. L’enquête distingue clairement deux dimensions : d’une part, les frustrations légitimes des communautés riveraines liées aux conditions de vie et aux infrastructures ; d’autre part, des accusations spécifiques de violences imputées aux CVV, qui ne reposent sur aucun témoignage direct en dehors de la vidéo.
Doléances réelles et accusations floues
Dans plusieurs localités, les habitants reconnaissent des difficultés sociales, mais n’évoquent aucune violence commise par des agents en service. À Mbonjo 2, les notables soulignent même des gestes de solidarité : dons de matériel, appui logistique pour le transport de marchandises, réunions périodiques de dialogue. Ainsi, les attentes demeurent certes fortes, mais le climat décrit n’est pas celui d’une terreur organisée.
Une réalité contrastée selon les villages, tant les constats de terrain révèlent que la relation entre la plantation et les communautés n’est pas uniforme. Certaines localités se sentent insuffisamment accompagnées, d’autres reconnaissent des efforts réels et un dialogue ouvert. Cette diversité d’expériences contredit l’image homogène et systémique d’un conflit généralisé véhiculée par la vidéo.
L’ombre de l’instrumentalisation
L’enquête met également en lumière un risque d’amplification ou d’interprétation militante de faits isolés. En effet, plusieurs interlocuteurs estiment que certains incidents sont reformulés pour alimenter un récit global, associant des cas individuels à des accusations collectives.
La confusion volontaire entre un sous-traitant isolé et les CVV illustre cette tendance. Un tel procédé, s’il attire l’attention publique, complique le dialogue entre riverains, autorités et entreprise, et peut affaiblir les causes locales qu’il prétend servir. En transformant des doléances légitimes en accusations massives, il détourne les efforts d’un débat constructif.
Notre enquête de terrain a permis de mettre la lumière sur plusieurs points. D’abord, qu’aucune plainte officielle n’a été enregistrée. Le mari de la victime affirme que l’agresseur n’était pas membre des CVV. Aussi, l’entreprise n’a jamais été informée, rendant toute action impossible. Enfin, aucun témoignage ne corrobore l’existence de violences organisées par des agents identifiables.

L’enquête montre que la vidéo repose essentiellement sur un récit personnel non vérifié. Elle met toutefois en lumière des questions légitimes liées aux conditions de vie des populations riveraines, sans établir de preuves d’un système de violences orchestrées.
Les leçons de l’affaire Soppo
La mission de terrain conduit à une lecture sobre et factuelle. Les frustrations des populations existent et appellent des réponses adaptées ; la cohabitation entre les entreprises agro-industrielles et les communautés exige transparence et vigilance ; mais l’affaire Soppo, telle que diffusée en ligne, ne résiste pas à l’examen des faits.
La responsabilité sociale, pour être crédible, ne peut se bâtir ni sur l’omission des problèmes, ni sur leur amplification sans preuves. Elle repose sur un travail patient, rigoureux et fondé sur la parole vérifiée. À l’heure où les réseaux sociaux façonnent l’opinion, la vérification demeure un devoir sacré. Notamment, pour la justice due aux victimes, pour la responsabilité des entreprises et pour la crédibilité des acteurs de la société civile
Cheikh Malcolm Radykhal EPANDA