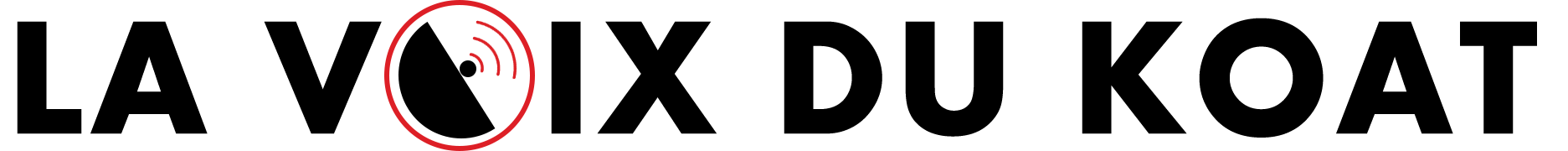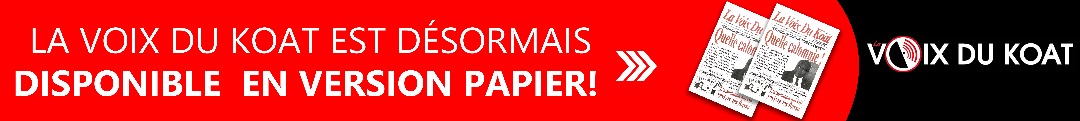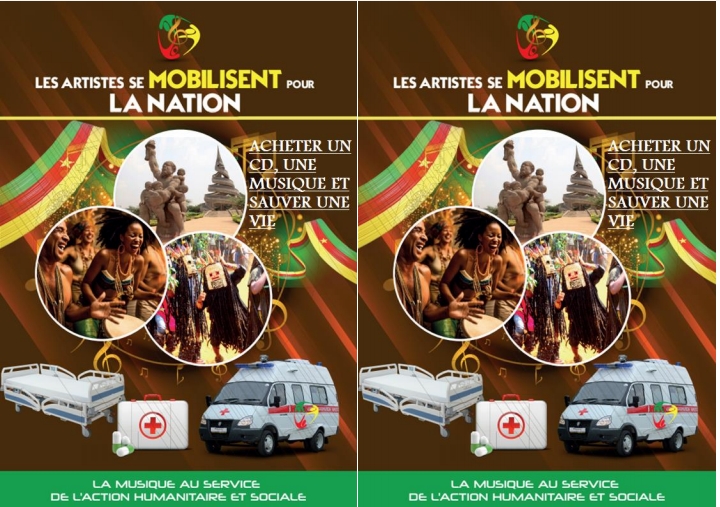Le programme de relance du replanting par la Socapalm a provoqué l’ire des villageois qui dénoncent une occupation illégitime de leurs terres. Entre mémoire coloniale, inertie administrative et luttes sociales, Apouh cristallise les tensions d’un héritage foncier jamais résolu.
Le ciel d’Apouh, d’ordinaire paisible, s’est assombri sous le poids des tensions qui courent depuis des décennies. Ce mardi, 25 mars, l’aube s’est levée sur un village en effervescence, où la terre, jadis fertile et généreuse, est devenue l’épicentre d’un combat silencieux, mais puissant. Au cœur du tumulte, une foule hétéroclite constituée de jeunes au regard déterminé, des anciens portant sur leurs épaules le poids de la mémoire, et des femmes drapées dans des étoffes rouges, couleur de la résistance et du deuil mêlés. Elles sont venues, sous la bannière d’Afrise, témoigner de leur refus et poser un acte de défiance face au replanting annoncé par la Socapalm. Sur le terrain, l’air est lourd, chargé d’une tension palpable. À chaque coin, la silhouette imposante des forces du maintien de l’ordre rappelle que le pouvoir s’exerce aussi par la force et la dissuasion. La Brigade anti-émeute, déployée en masse, veille, prête à contenir la moindre déflagration. Face aux villageois, l’administration campe sur ses positions. Entre les rangs des forces de l’ordre et ceux des villageois, un mur invisible s’érige, symbolisant bien plus qu’un simple affrontement, une fracture historique.
Héritage Foncier Colonial en Suspens
La récente reprise des travaux de replanting de la Société Camerounaise des Palmeraies (Socapalm) a ravivé une tension latente entre l’entreprise et les riverains, aboutissant à une confrontation où s’entremêlent enjeux économiques, revendications sociales et inertie administrative. L’histoire de ce contentieux ne date pas d’hier. Elle plonge ses racines dans la période coloniale, époque à laquelle les terres d’Apouh ont été cédées à des exploitants étrangers, provoquant l’expropriation des populations locales. Avec les décennies, les structures se sont succédées. D’abord la SProA, puis la Société des Palmeraies de la Ferme Suisse (SPFS), avant que la Socapalm, filiale du groupe Socfin, ne devienne propriétaire en 2010. Ce passé tumultueux est aujourd’hui l’épicentre d’une opposition farouche, où les riverains dénoncent une occupation jugée illégitime et réclament la restitution de terres vitales pour leur développement. « La Socapalm ne saurait être l’interlocuteur des riverains sur les revendications foncières alors que nous payons notre bail à l’État », nous explique un cadre de cette société que nous avons rencontré. Et qui rappelle dans une de nos précédentes éditions que la société s’acquitte de son bail auprès de l’État et qu’en conséquence, elle n’a pas vocation à être l’interlocutrice des revendications foncières.
L’impasse administrative
Confrontée à cette hostilité, la Socapalm adopte une posture de neutralité et de légitimité juridique. À travers une correspondance adressée au Préfet de la Sanaga-Maritime, elle rappelle, avant le début des travaux, que son opération ne relève pas d’une expansion, mais bien d’un renouvellement de ses plantations sur des terrains dont elle détient les titres fonciers. « La Socapalm ne fait pas d’extension, c’est une opération de replanting qui vise à améliorer notre productivité. » L’entreprise souligne par ailleurs l’inaction administrative face à une situation qui, au fil des ans, n’a trouvé aucune issue satisfaisante. Alors que le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (Mindcaf) avait ordonné des travaux cadastraux afin de clarifier les limites foncières contestées, ces derniers demeurent bloqués, faute d’initiatives concrètes de la part de l’autorité administrative locale. Cette inertie entretient la confusion et alimente la frustration des riverains, qui se sentent abandonnés par les autorités censées arbitrer ce litige. « Le travail demandé par le Mindcaf n’a pas été fait. Pour quelle raison ! Et l’État pense que c’est par l’intimidation que le problème sera résolu », s’étonne le Chef du village SM Ditope sur les prescriptions du Mindcaf qui ne sont pas appliquées sur le terrain et que des solutions provisoires ne sont pas mises en place. Sauf que, sur le terrain, la colère des villageois s’est heurtée à un dispositif sécuritaire impressionnant, déployé pour éviter tout débordement. « L’État prendra ses responsabilités lorsqu’il sentira qu’il y a trouble à l’ordre public », nous avait-on dit à la préfectorale. Sauf que la présence massive des forces de maintien de l’ordre a renforcé le sentiment de marginalisation des riverains, qui s’estiment muselés dans leur propre lutte. « L’administration nous a promis une issue, mais aujourd’hui, elle reste silencieuse et nous envoie les gendarmes en guise de réponse. Nous avons été dépossédés de nos droits par notre propre État », s’indigne Félicité Ngon Bissou, présidente des femmes Afrise. Face à la tension croissante, le Commandant de compagnie de la gendarmerie de la Sanaga-Maritime a tenté d’apaiser les esprits par un discours de pacification, appelant la population à la responsabilité civique. Mais l’absence d’un cadre de dialogue structuré entre les différentes parties et l’indécision des autorités ne font que reporter un problème qui, chaque année, revient avec la même intensité. D’un côté, la société déplore l’absence de tout cadre de dialogue, accusant le chef du village de s’emmurer dans une intransigeance inflexible et sourd à toute tentative de conciliation. De l’autre, ce dernier renvoie la faute à l’entreprise, qu’il juge hermétique à toute négociation, retranchée derrière son indifférence et de mépriser les revendications sociales. Pris dans ce ballet d’accusations croisées, l’État, pourtant attendu comme médiateur, demeure spectateur silencieux. Et pendant que chacun campe sur ses certitudes, le malentendu s’enracine et s’épaissit, nourrissant incompréhensions et tensions, or le terrain reste le théâtre d’un conflit figé dans l’impasse.
Lire aussi : Litige foncier à Edéa : Apouh et la Socapalm au cœur d’un contentieux foncier colonial
Si la Socapalm est pointée du doigt par les riverains, force est de constater qu’elle n’a fait qu’hériter d’un problème dont les racines sont bien antérieures à son installation. Ce sont les administrations successives qui ont entretenu le flou sur le statut de ces terres, enchaînant des décisions opaques et des promesses non tenues. Le chef du village, SM Ditope Lindoume, ne cache d’ailleurs pas sa frustration : « Nous n’avons aucun problème particulier avec la Socapalm qui n’est d’ailleurs pas a l’origine de la situation actuelle. L’État a lui-même reconnu que ces titres fonciers posaient problème, alors pourquoi ne fait-il rien pour clarifier la situation ? Nous demandons simplement le respect des engagements pris », affirme-t-il. Cette position est largement partagée par les habitants, qui réclament une rétrocession des portions de terres excédant les limites foncières légales ainsi que des garanties sur l’espace vital qui leur est nécessaire. « Nous réclamons seulement deux choses. L’espace vital et la rétrocession des dépassements de leurs titres fonciers. Nos yeux sont tournés vers l’autorité administrative qui devrait se soucier des intérêts des communautés », déclare Olkane Etamane.
Un avenir incertain
Malgré les nombreuses réunions administratives et les tentatives d’apaisement, le conflit entre la Socapalm et les riverains d’Apouh semble encore loin d’une résolution. La sécurisation des travaux par les forces de l’ordre ne constitue qu’une réponse ponctuelle, sans traiter le fond du problème. Loin de se réduire à un simple affrontement entre une entreprise agro-industrielle et une communauté villageoise, cette affaire met en lumière les carences d’un État qui, en ne remplissant pas son rôle d’arbitre, laisse des tensions historiques se perpétuer. Tant que des mesures concrètes ne seront pas prises pour clarifier définitivement la situation foncière, Apouh restera le symbole d’un conflit hérité du passé et entretenu par l’indécision du présent.
Cheikh Malcolm RADYKHAL EPANDA