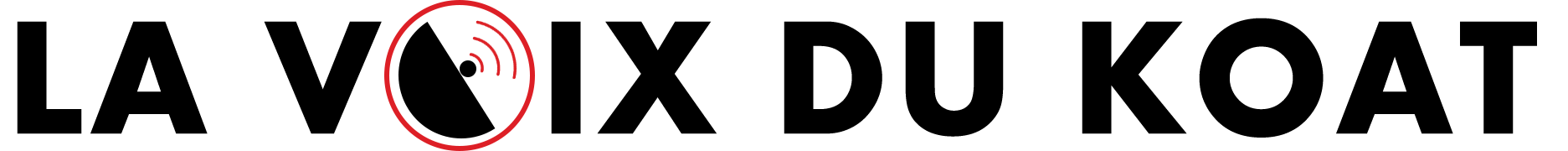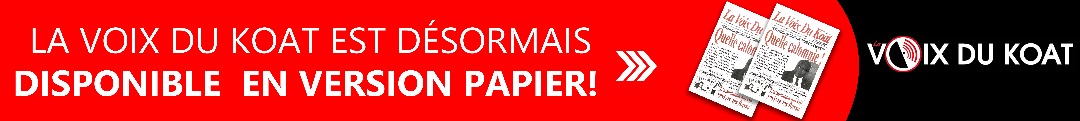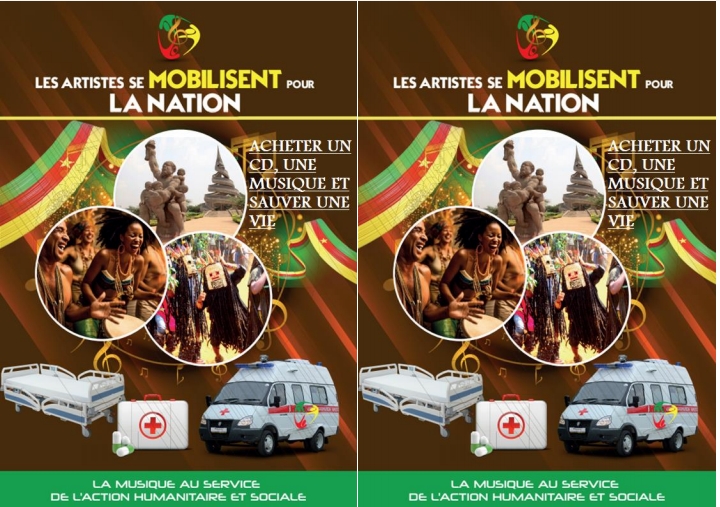Situé en plein cœur du Cameroun, à la croisée des chemins entre Edéa 2 et Dizangue, Mevia est un symbole de résilience et de détermination. Cette localité, qui a connu de nombreuses épreuves, se relève progressivement grâce à la volonté collective de ses habitants.
Le village de Mevia, situé à la frontière des arrondissements d’Edéa 2 et Dizangue, est un véritable point de convergence, non seulement sur le plan administratif, mais aussi sur le plan économique, car il est baigné par les eaux du lac Ossa, une étendue d’eau qui joue un rôle capital dans la vie du village. Cette position lui confère un rôle de convergence et un emplacement géographique stratégique, en le plaçant à la jonction de plusieurs influences et ressources naturelles, tout en lui offrant une certaine visibilité dans l’organisation administrative de la région. Non un simple élément naturel, ce lac qui borde le village, est une source de richesse halieutique essentielle pour la population, véritable « mamelle nourricière » grâce aux produits halieutiques abondants qu’il recèle. Cette ressource, constituée principalement de poissons et autres produits aquatiques, est essentielle à la subsistance des habitants, qui en font leur principale source de revenus et de nourriture.
Entre espoir et résilience
Malgré cette richesse naturelle, le village a traversé une période difficile et est confronté aujourd’hui à plusieurs maux qui plombent son développement. Le village a connu un exode radical des populations poussées par le désir de trouver de meilleures conditions de vie vers Edéa, Songueland et Ekitè. Ce phénomène, largement répandu dans de nombreuses régions rurales, a eu des répercussions profondes sur le village, rendant sa survie totalement livide. Aujourd’hui, les terres fertiles sont devenues moins cultivées, et les habitations ont perdu de leur densité. Le village, autrefois animé par une vie communautaire forte, s’est vu privé d’une grande partie de sa force de travail et de son savoir-faire local. Ce départ des populations a profondément affecté le tissu social du village, marquant la fin d’une époque de prospérité et de cohésion. Par ailleurs, la prolifération de la Salvinia Molesta, une plante aquatique invasive, a aggravé la situation en menaçant la biodiversité du lac et les ressources halieutiques, entraînant ainsi une baisse drastique de l’activité et la fuite des pêcheurs des campements. La déforestation, due à la coupe sauvage de bois, et la vente de terres, souvent au profit de personnes extérieures au village, sont d’autres problèmes majeurs auxquels MEVIA est confronté. Ces pratiques ont des conséquences environnementales et sociales désastreuses, notamment en ce qui concerne la chefferie traditionnelle, source de conflits et de divisions.

Entre espoir et solidarité
Ces dernières années ont vu un retournement de situation. Une dynamique nouvelle impulsée par la volonté de la communauté villageoise ayant à sa tête Sa Majesté Passy Ebegnè Makoumack, s’est instaurée. Ces populations sont marquées par la volonté de retrouver les terres ancestrales enclines à la braderie foncière. Ce phénomène est en grande partie dû aux efforts de développement entrepris par les habitants eux-mêmes, en collaboration avec des initiatives locales impulsées par son Chef traditionnel Sa Majesté Passy. La dynamisation de la pêche, avec des investissements dans le matériel et la formation, est également une priorité. En effet, la construction de routes reste un cheval de bataille pour désenclaver le village et faciliter l’accès aux autres régions, contribuant ainsi à la revitalisation économique de la zone. De plus, la construction d’écoles montre l’engagement envers l’éducation et la formation des jeunes générations, éléments essentiels pour assurer un avenir durable au village. En parallèle, la collaboration entre la chefferie traditionnelle et les services démembrés de l’Etat ont mis en place des stratégies pour dynamiser le secteur de la pêche, avec des investissements dans l’acquisition de matériel et la formation des pêcheurs, afin de stimuler la production et la rentabilité du secteur halieutique.
Une autre marque de cette renaissance est la construction de nouvelles maisons, preuve tangible de l’installation progressive de nouveaux habitants et du retour des exilés. Ces constructions symbolisent non seulement un retour à la vie rurale, mais aussi l’ancrage des familles dans le village. La volonté de bâtir, à la fois physiquement et symboliquement, représente la force de la communauté, qui, malgré les épreuves du passé, reste déterminée à retrouver sa prospérité d’antan.
Aujourd’hui, Mevia connaît une véritable résurgence. Les habitants, nourris par une volonté de reconstruction et de renouveau, se battent pour le développement et la prospérité de leur village. Cette détermination se traduit par un esprit de solidarité collective et un désir profond d’améliorer leurs conditions de vie. Chaque effort, qu’il s’agisse de la construction d’infrastructures, de l’amélioration des conditions de travail ou du renforcement du tissu social, participe d’une ambition commune de redonner vie et espoir à Mevia.

Les populations ne se contentent pas de reconstruire leur village, elles réaffirment leur attachement à leurs racines et œuvrent pour un avenir meilleur, portées par l’esprit de communauté et le rêve d’une prospérité partagée. Ainsi, le village de Mevia se trouve à un carrefour où, tout en étant marqué par les cicatrices du passé, s’engage résolument vers un avenir fait de reconstruction, d’unité et de croissance. L’histoire de Mevia est un exemple de résilience et de la capacité d’une communauté à surmonter les difficultés pour construire un avenir meilleur, un témoignage poignant des défis de la ruralité, mais aussi de la force de résilience et de l’espoir de ses habitants.
Cheikh Malcolm Radykhal EPANDA