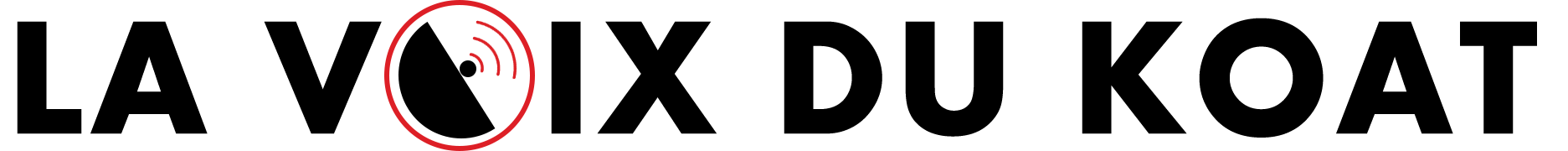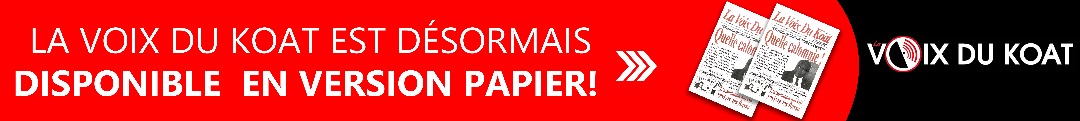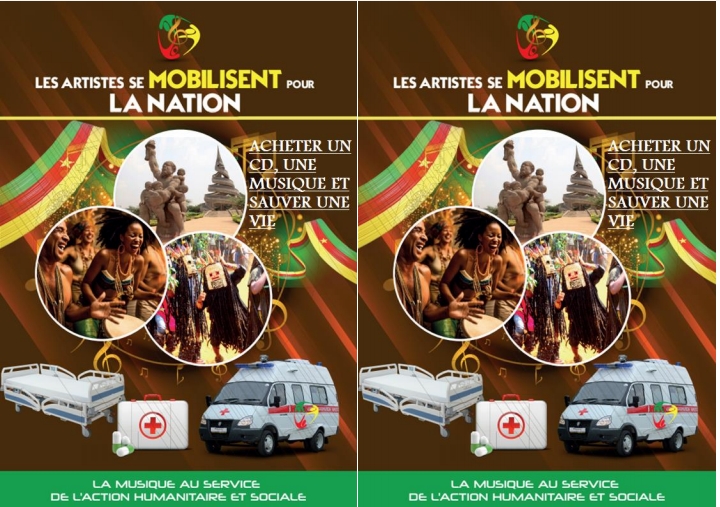En ce 25 novembre, le monde célèbre la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, une journée qui rappelle l’urgence de combattre un phénomène profondément enraciné dans les sociétés. Malgré les avancées législatives et les campagnes de sensibilisation, les violences demeurent omniprésentes, aussi bien dans la sphère familiale que dans le milieu professionnel. L’analyse des chiffres mondiaux révèle une situation alarmante nécessitant une mobilisation collective renforcée.
Les données récentes publiées par les organisations internationales montrent que près d’une femme sur trois dans le monde a subi au moins une fois des violences physiques et sexuelles. Cette proportion, rapportée par l’Organisation mondiale de la santé, équivaut à environ 840 millions de femmes, un chiffre qui illustre la profondeur du problème. Le foyer, censé être un espace de sécurité, demeure paradoxalement l’endroit le plus dangereux pour de nombreuses femmes. Les estimations indiquent qu’environ 51 100 femmes ont été tuées en 2023 par un partenaire intime ou un membre de leur famille, soit une moyenne de 140 victimes par jour. Le phénomène semble d’autant plus préoccupant que le recul de ces violences reste extrêmement lent, avec une baisse annuelle de seulement 0,2 % selon UN Women, un rythme qui montre que le monde peine encore à protéger les femmes contre ces atteintes fondamentales à leur intégrité.
Violence domestique : l’intimité en péril
La majorité des violences subies par les femmes se déroulent dans la sphère privée, où les mécanismes de domination sont souvent invisibles et difficiles à dénoncer. De nombreuses victimes rapportent des agressions physiques, des violences sexuelles, mais également des formes plus silencieuses de violence psychologique, économique ou sociale. La stigmatisation, la dépendance financière, la pression familiale et la peur des représailles contribuent au silence des victimes et favorisent l’impunité des auteurs. Le féminicide représente la forme la plus extrême de ces violences et reflète l’échec des dispositifs de prévention et de protection. Dans certaines régions du monde fragilisées par la pauvreté, l’instabilité politique ou les conflits armés, les taux de violences sont nettement plus élevés, ce qui accroît la vulnérabilité des femmes et limite leurs possibilités d’accéder à la justice.
Au-delà du foyer, le lieu de travail constitue un autre espace où les femmes subissent des formes variées de violences. Selon une enquête menée par l’Organisation internationale du travail, un peu plus d’une personne sur cinq déclare avoir subi des violences ou du harcèlement dans le cadre professionnel, qu’il s’agisse de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Les femmes demeurent les plus exposées, notamment celles occupant des postes précaires, les jeunes travailleuses et les migrantes.
Les violences professionnelles sont souvent liées à des rapports hiérarchiques déséquilibrés, à l’absence de culture de prévention et à la normalisation de comportements hostiles. La peur de perdre son emploi, les menaces de représailles, l’absence de mécanismes de signalement sécurisés et le manque de soutien institutionnel contribuent à maintenir ces violences dans l’ombre. Certaines femmes en position de responsabilité font également face à des violences psychologiques et à des tentatives de déstabilisation liées à leur genre, révélant que la montée en compétence féminine dérange encore certains milieux professionnels.
Lire aussi :Jif : la percée des violences faites aux femmes, inquiète la Cdhc
Les violences faites aux femmes, au-delà de leur forme immédiate, s’enracinent dans des structures sociales où persistent des normes patriarcales et des stéréotypes de genre. Ces systèmes perpétuent une vision hiérarchisée des rôles féminins et masculins, légitimant parfois l’autorité abusive des hommes. Les conséquences de ces violences sont multiples. Sur le plan physique et mental, les femmes victimes présentent des traumatismes, des troubles anxieux, des dépressions, des blessures graves, et parfois des répercussions sur la santé reproductive. Sur le plan social et économique, les violences réduisent l’employabilité, fragilisent les carrières professionnelles, accentuent la précarité et engendrent des pertes économiques considérables pour les entreprises et les États. Les violences se transmettent également dans les familles et les communautés, créant un cercle intergénérationnel de souffrance et d’inégalités.
La lutte contre les violences faites aux femmes exige une approche globale mobilisant les États, les entreprises et les communautés. Le renforcement des lois et de leur application constitue un premier levier essentiel. Dans de nombreux pays, les cadres juridiques existent, mais les moyens pour les mettre en œuvre restent insuffisants. Il est indispensable de financer les programmes de prévention, d’améliorer la formation des services de police et de justice et de favoriser l’accès à des structures d’accueil capables d’offrir un soutien psychologique, médical et juridique.
Les entreprises doivent également jouer un rôle central en mettant en place des politiques internes claires, des formations obligatoires, des procédures de signalement confidentielles et des sanctions fermes contre les auteurs. Une culture organisationnelle fondée sur le respect et l’égalité contribue à réduire les risques et à libérer la parole des victimes.
Enfin, les communautés, les médias et les acteurs de la société civile doivent poursuivre leurs efforts de sensibilisation afin de transformer les mentalités, de briser les tabous et de valoriser les initiatives positives. L’éducation à l’égalité, dès le plus jeune âge, demeure l’un des moyens les plus efficaces de combattre durablement les violences.
La Journée internationale du 25 novembre rappelle que la violence faite aux femmes demeure l’une des violations des droits humains les plus répandues au monde. Les chiffres attestent de son ampleur et de sa persistance, que ce soit dans les foyers ou sur les lieux de travail. Mais ils soulignent également l’urgence d’une mobilisation continue. La lutte contre ces violences nécessite des actions coordonnées, des politiques ambitieuses, un soutien accru aux victimes et une transformation profonde des normes sociales. Un avenir plus sûr pour les femmes repose sur la volonté collective de rompre le silence, de résister à l’impunité et de défendre l’égalité avec détermination.
LÉONEL AKOSSO