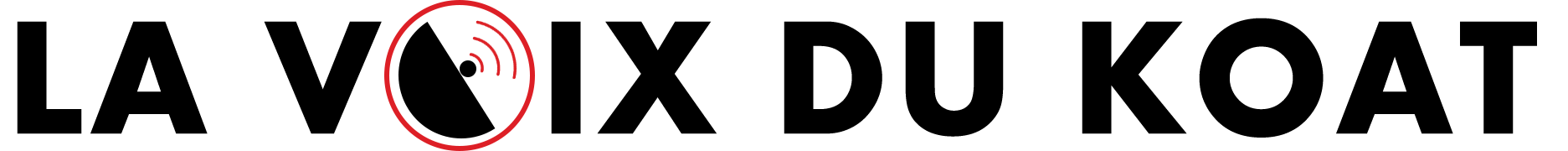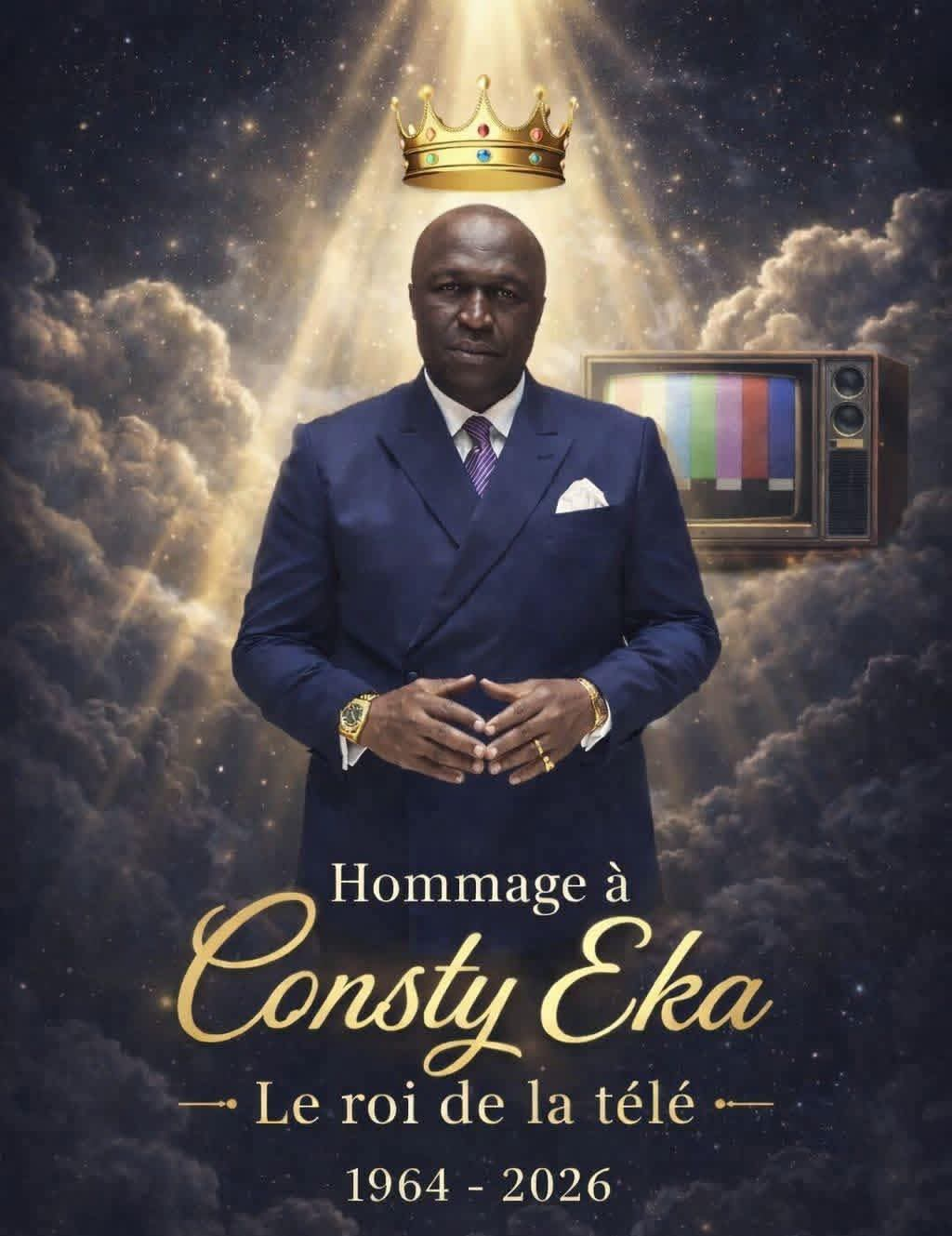Professeur de saxophone au Conservatoire de Niort à Paris, Jean Jacques Elangue est saxophoniste, interprète, compositeur… En terre camerounaise depuis quelques jours pour le concert avec Emmanuel Pi Djob, il a accordé une interview à bâtons rompus à La Voix Du Koat.
LVDK : Vous avez accepté d’accompagner Emmanuel Pi Djob sans argent ?
Sans argent c’est un bien grand mot. Ce n’est pas pour un cachet que je suis venu parce que le cachet qu’on a est dérisoire. C’est plutôt ce qu’il faut dire, pour dire les choses comme il faut. Je connais l’artiste Emmanuel. Nous faisons des collaborations dans le sens du bon procédé. J’ai eu à inviter Emmanuel dans mes productions, dans mes albums, notamment dans l’album «Missunga» qui est sorti chez Christal Record en 2004. Emmanuel est venu chanter sur un de mes titres et inversement, quand il a besoin de moi je suis là. C’est le cas notamment du disque qu’il présente ici dans lequel il a fait appel à moi et une partie de l’équipe «Kelen Kelen» que je codirige ici avec Brice Wassy pour participer dans l’album. Chose que nous avons faites. Cette collaboration est un échange de bon procédé entre Emmanuel et moi, de part le fait que nous sommes d’abord des amis d’enfance. Nous avons grandi à Yaoundé dans le cocon familial, autour de l’église Marie-Gocker où il avait commencé à faire de la musique. On se connait depuis cette époque, les années 70. J’aime le pays bien sûr, mais si ce n’est pas Emmanuel qui me l’avait demandé je ne serai jamais venu. Je connais Emmanuel c’est pour cela que j’ai accepté de venir, ça ne veut pas dire que je ne peux pas venir par mes propres moyens. Attention ! Ne mélangeons pas tout. Là je suis venu travailler avec Emmanuel.
LVDK : Pourquoi êtes-vous si rare sur la scène camerounaise ?
Je ne vis plus ici, même si une partie de ma vie est ici. Je suis parti assez jeune et ça été un choix. Avant de partir, je revenais de l’Europe parce que j’y suis né, et je suis parti pour faire une carrière de musicien. Mais si vous regardez mon palmarès, vous verrez que je suis revenu il y a quelques années. En 2004 par exemple je suis revenu pour un concert. Je reviens aussi pour voir ma famille. Les conditions n’ont pas été réunies pour que je me fasse inviter pour faire de la musique ici sous mon nom. Ça ne dépend pas que de moi et puis il faut se battre. Là où je suis il faut se faire un nom. Je m’occupe plus de ça. Je vis et je m’active là où je suis et ce n’est pas une chose facile. Je vis à Niort parce que je donne des cours au conservatoire de Niort, je suis responsable du département Jazz au conservatoire Nuant.
LVDK : Pourquoi avoir choisi le saxophone pour vous exprimer ?
C’est une très bonne question. Le saxophone m’est venu de part le fait que j’étais à l’internat au collège Vogt et il y avait une pratique assez soutenue dans le cadre de l’harmonie du collège. C’est comme ça que j’ai intégré la fanfare et l’orchestre. Ça été un apprentissage était assez ludique, c’est-à-dire que le responsable qu’on avait en face de nous nous a fait jouer de la musique de manière un peu formelle. Ce n’était pas un apprentissage super précis, mais on a appris à jouer ensemble, à lire la musique et c’était passionnant. Depuis ce moment là, j’ai décidé très tôt, à 14 ans, que j’allais devenir musicien.
LVDK : Pourquoi le Jazz ?
Le Jazz parce que le saxophone est un instrument qui a vraiment trouvé sa place dans cette musique. Je n’avais pas trop de références pour pouvoir travailler mon instrument et la musique de Jazz m’a permis de travailler l’instrument, de le découvrir un peu plus. Mais ce n’est qu’un instrument. J’utilise le saxophone comme un instrument. En fait j’ai une voix. J’essaie à travers le saxophone de dire ce que j’ai au fond de moi. Le saxophone n’est qu’un vecteur, d’ailleurs je n’ai jamais pris un cours de saxophone. Je suis un autodidacte à la base. J’ai fait des études de musique, j’ai appris à composer, à arranger, à diriger. J’enseigne, je donne même des cours de saxophone mais je n’ai jamais pris un cours de saxophone. C’est bizarre. J’ai commencé à apprendre ici à Yaoundé. Mon parcours commence au collège Vogt, ensuite je me retrouve dans le milieu des «gombistes». J’accompagnais des artistes à gauche et à droite. J’ai été appelé pour faire partir du premier orchestre qui jouait au Hilton en 1989-1990. J’ai fait deux ans, un stage assez ardu de musiciens professionnels avant de me retrouver de l’autre côté, au conservatoire en passant par des troupes de théâtre.
LVDK : Parlez-nous du projet Kelen Kelen. Que devient-il ?
Le projet Kelen Kelen est né en 2011, de la volonté et de la collaboration de deux musiciens. C’est-à-dire Brice Wassy, batteur, compositeur et moi-même, Jean Jacques Elangue, saxophoniste, compositeur. On a décidé de monter ce projet qui est basé sur la participation des musiciens de la diaspora. Le projet est de parcourir et revisiter les musiques qui nous ont bercées, nous les deux Camerounais qui avions fondé le Kelen Kelen. Mais pour ça, on a eu besoin de nous entourer des musiciens de la diaspora, c’est-à-dire des Américains, des Haïtiens, des Réunionnais, des Martiniquais, des Guadeloupéens…tout ce qui est noir autour de nous, pour dire ces choses là. Reprendre la musique de notre terroir, tout en apportant les compositions qui sont inspirées de la musique traditionnelle de chez nous. Ça commence par le Magabeu, ça passe par le Bikutsi en allant sur le Makounè, le Ngosso…

LVDK : Quand vous êtes avec Kelen Kelen, vous êtes très Afrique, mais vos albums en solo sont d’un autre univers…
C’est voulu. Kelen Kelen est une passerelle pour moi pour que dans mon pays, on me regarde et voit d’un autre œil. C’est ce que je regarde même quand je fais du Jazz. Ma musique est inspirée d’ici même si j’ai un background qui est complètement ancré dans le Jazz. Je le revendique. C’est ce que j’enseigne au conservatoire mais je suis Camerounais à la base. Mon village est à deux pas d’ici, à Ngodi Bakoko. Je suis Camerounais de nationalité française.
LVDK : Vous avez été inspiré par John Coltrane et Charly Parker. Pourquoi Coltrane, quelqu’un dont la musique était considérée comme inaccessible, mystique ?
Tout à l’heure quand vous m’avez demandé pourquoi le saxophone, je vous ai parlé de l’idée que le saxophone est un vecteur pour moi. Coltrane ici à l’occurrence a un truc qui rappelle la transe à chaque fois. Le saxophone qu’il joue n’est qu’un vecteur pour nous fait passer toutes ces émotions. Il y a une histoire de transe. Ce que vous me voyez faire dans Kelen Kelen est l’aboutissement un peu de ce que j’entends depuis mon ventre et depuis mes oreilles. Le saxophone n’est qu’un vecteur. Le message c’est de faire passer aux gens l’idée selon laquelle on peut faire notre musique en utilisant des codes de la musique occidentale mais tout en gardant en profondeur le message de base qui est ‘‘ nous savons d’où nous venons, quoiqu’il arrive sur le chemin qui nous attend devant nous. Nous avons nos racines ici. Même si je ne suis pas fréquent sur le terroir’’. Mes parents sont ici. Ils sont vieux. Toutes les semaines je suis au courant de tout ce qui se passe. Je suis sollicité, vous savez ce que s’est que d’être un immigré. Mais ma vie c’est la musique. C’est ma drogue à moi. Il a fallu que je fasse des choix et ce n’est pas toujours facile. Le choix que j’ai fait, de vivre en marge de mes racines n’est pas facile. C’est pour ça que dans Kelen Kelen vous entendez ce son. Je suis un Camerounais complet. Je parle bassa, bakoko, duala, éton…même si je suis parti il y a 25 voire 30 ans, je reste très connecté.
LVDK : Avec l’expansion des musiques dites urbaines, est-ce que le Jazz n’est pas en péril ?
Le Jazz comme on dit habituellement est né aux Etats-Unis, mais il n’est pas né tout seul. Il est né du fait de l’histoire. C’est comme une fleur qui résiste sur un champ de ruine. C’est un art qui a été créé aux Etats-Unis avec un gros apport venant de l’Afrique. Aujourd’hui on entend chez les jeunes générations, les musiques qui sont cousines du Jazz comme le Hip-Hop, le Rap. Actuellement, dans nos sociétés on a tendance à dire que c’est un aboutissement. Mais il y a des racines derrière. Avant d’arriver sur le Hip hop, il y a des bases, les rythmes traditionnels de chez nous. Le Jazz ce n’est pas seulement les Etats-Unis. C’est aussi une grosse part de ce que nous faisons. Le Jazz est toujours là. La preuve c’est que vous avez une grande partie de la population qui, malgré le fait qu’elle ne veut pas changer ses habitudes, s’accroche quand même à ce qui a été fait avant. C’est vrai qu’à la base le Jazz a toujours su s’adapter aux autres musiques. On le voit aujourd’hui. Le gars qui fait du Rap va toujours se mettre à côté de lui un instrumentiste qui a des envolées de Jazz. Pour le public, ce qu’on appelle Hip hop, qu’on le veuille ou non vient quelque part du Jazz. Donc il y a un lien, même si on a l’impression que le Jazz est en train de mourir.
LVDK : Qu’est-ce que vous avez retenu de l’expérience ‘’Jazz sous le manguier’’ ?
Une très bonne expérience. Je suis un pur fruit de cette initiative. J’étais adolescent quand j’ai commencé à participer à ce festival, entre 16-17 ans. Petit à petit, ça a amené des rencontres. J’ai pu avoir la chance à cette époque d’avoir une bourse pour un stage en musique en théâtre en France. Grâce au festival ‘‘Jazz sous le manguier’’, j’ai pu rencontrer des personnes qui pouvaient prendre des décisions.
LVDK : Est-ce que la disparition de ce festival n’est pas la raison pour laquelle les saxophonistes Camerounais ne sont pas très connus. Ils sont reconnus à l’international, mais pas au pays…
Il ne serait pas bien de plutôt poser la question aux organiseurs. Pourquoi n’y a-t-il pas d’autres festivals pour justement fédérer cette évolution ? Il nous manque des festivals dans ce sens. Le ‘‘Jazz sous le manguier’’ est terminé mais ce n’est pas la fin du monde. Si mes souvenirs sont bons, il y a eu un festival à Yaoundé dans ce sens au début des années 2000. C’est du ressort des organisateurs, des sponsors.
LVDK : Combien d’albums en tant que leader ?
J’en ai trois. Le premier, «Héritage» qui est une autoproduction. Le deuxième c’est «Missunga» sorti il y a plus de dix ans. Le troisième que j’ai fait en duo avec un pianiste Américain super connu, -malheureusement nous a quittés au mois de mai- Tom Mc Clung. S’agissant des disques en collaboration, j’en ai fait pas mal.
LVDK : Quel est votre agenda après ce spectacle ?
Après ce spectacle je continue sur la réalisation du projet Kelin Kelin. On est en train d’enregistrer le disque de Kelin Kelin. Ça va être un point de départ pour lancer la carrière de Brice Wassy et la mienne. Je suis aussi engagé sur d’autres projets, ‘‘Three for three’’, un trio de saxophones. On a lancé cette année sur un festival qui se déroule à Montreuil en région parisienne. Ce qui me préoccupe le plus c’est d’aboutir le travail de Kelin Kelin que nous avons commencé. C’est très important.
LVDK : Si vous devriez dire un mot sur Manu Dibango…
C’est un sage. C’est quelqu’un que je connais particulièrement, que j’ai eu la chance et l’occasion de rencontrer ces dernières années. C’est un sage, une référence. Si je disais un mot c’est papa. Il est le père de la musique africaine. Il a montré le chemin aux musiciens, pas seulement aux saxophonistes. Je ne me définie pas en tant que saxophoniste. J’ai une voix. Je suis artiste musicien. Le saxophone c’est l’instrument que je joue mais je joue aussi du piano, de la contrebasse.
LVDK : Comment jugez-vous la musique africaine aujourd’hui ?
Avant de dire un mot sur la musique africaine il faudrait peut-être avoir la définition claire de ce qu’on entend par la musique africaine. On entend beaucoup de choses et c’est de là que partent les problèmes. Je dirai qu’il faut continuer à surfer sur les racines de notre culture pour s’exprimer en musique. C’est ça ma définition de la musique africaine. La musique africaine telle que les occidentaux veulent l’entendre c’est la World music. Je sors complètement de ce cadre là. Pour moi la musique africaine c’est ce que j’entends dans la rue, ces klaxons là, ces chants qu’on entend dans les villages. C’est ce qu’on doit développer et c’est possible. La musique africaine vivra, elle est là. Sauf qu’on est détourné par une espèce de dictature du marché qui voudrait qu’on soit dans une case, world music, et que tout le monde le fasse. La musique africaine a du chemin à faire, mais heureusement, elle est riche.
LVDK : Pour un homme de 50 ans vous êtes très bien conservé. C’est quoi votre secret ?
J’ai pris conscience assez tôt. Premièrement il faut faire très attention à l’alcool, aux abus. Ce n’est pas la peine de boire. Il faut avoir une hygiène de vie, pouvoir dormir si on peut. Je bois de l’eau avant de me coucher, je bois de l’eau au réveil, je fais des exercices, des pompes tous les matins, je marche. Je ne fais pas d’excès, je reste à ma place. Je suis concentré sur la musique, c’est la seule drogue que je prends.
LVDK : Vous avez baptisez votre saxophone comme le font généralement les musiciens?
Oui. C’est la vieille dame, The old lady. La vieille dame parce qu’il est de 1929. Je l’amène toujours en réparation, je m’en occupe bien. Le nom m’est venu de mon luthier qui répare mes instruments. C’est lui qui a dit ‘‘c’est une vieille dame ton instrument. Toujours en train de lui donner une béquille par ci’’. Mais ça fonctionne. J’ai utilisé cet instrument pour tous mes enregistrements, sauf pour le premier disque. J’en ai deux autres mais celui que j’ai là, le favori, c’est The old Lady.
Entretien avec Valgadine TONGA