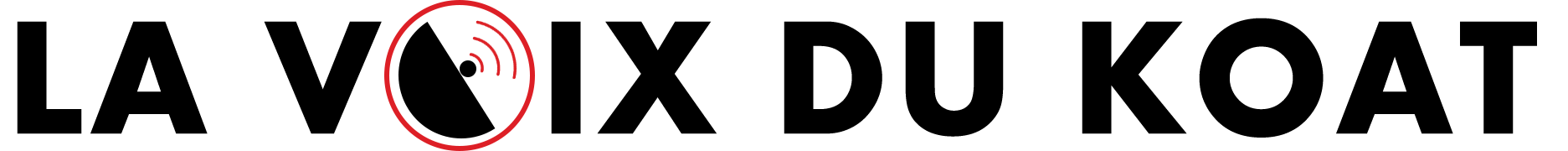Il porte le Cameroun haut dans son cœur, même si le retour d’ascenseur bloque. La dextérité de sa batterie est magnifiée à travers le monde. Parlez de lui en Afrique du Sud de Miriam Makeba, au Mali de Salif Keita, en France de Luc Ponty…et vous verrez la déferlante de superlatifs. Batteur, saxophoniste, producteur, compositeur entre autres, Brice Wassy (de son vrai nom Brice Wouassi) pulvérise à travers le monde, sa musique aux fortes sonorités camerounaises et africaines. A 62 piges, le fils «mal aimé» du Cameroun fait une pause pour jeter un regard dans le rétroviseur, et scruter l’horizon. Trajectoire, anecdotes, trahisons, frustrations…, Brice Wassy se livre à nous dans cette interview à bâtons rompus a accordée à La Voix Du Koat et au quotidien Mutations.
Une bonne partie du monde loue votre génie, vos œuvres. Votre carrière jusqu’ici est un franc succès, pourtant votre pays vous connaît que très peu. Qui est Brice Wassy ?
Brice Wassy est un batteur, compositeur. Ça fait quelques années que je joue. J’ai commencé très tôt. Je suis né à Yaoundé, il y a 62 ans aujourd’hui. Je suis parti en France en 1974, à 17 ans. Mais j’ai joué au Cameroun avant de partir. J’ai joué à l’Orchestre du Collège Noir de Mbalmayo, on était le meilleur orchestre scolaire de l’époque. J’ai commencé sur des casseroles comme beaucoup de jeunes. Ma petite histoire en fait c’est que j’habitais Nkomkana à Yaoundé, non loin du domicile d’un batteur. Il voyait comment je jouais sur les casseroles. A l’époque il y avait un club qui s’appelait Artisan Bar, où se trouve l’Hôtel Le Progrès aujourd’hui. Puisque nous étions mineurs, l’accès nous était interdit. On les écoutait de l’extérieur. A un moment, ce batteur est sorti. Il a pris ma main, il m’a porté et m’a mis devant la batterie. C’était un grand orchestre avec tous les instruments. Je ne sais plus ce qu’on avait joué, mais c’était génial pourtant c’était la première fois que je touchais à une batterie. J’avais 10 ans. J’étais émerveillé. Tout le monde m’a porté et on scandait «le petit Brice». Tout le quartier était au courant, résultat, j’ai reçu une fessée souveraine des parents quand je suis rentré. Ils disaient que les musiciens sont des voyous. J’ai continué au collège, en jouant également parce que j’étais doué. Dans ma famille maternelle avec laquelle j’ai grandi, tous mes oncles étaient des percussionnistes, donc j’ai vraiment entendu les tambours. Puis je suis allé retrouver mon père en France.
Comment se fait-il que vous soyez peu ou pas connu sur la scène nationale ?
C’est un peu de ma faute aussi. Nous sommes les musiciens chercheurs, c’est d’ailleurs comme ça qu’on me qualifie ici. Même à l’époque du makossa, on disait que nous sommes jazz. C’était une manière d’écarter certaines personnes. J’ai fait des disques, mais pas des chansons. Je fais de la musique instrumentale. C’est l’une des raisons pour lesquelles je ne suis pas très connu. Il y a aussi le manque de promoteurs. Mais beaucoup de musiciens me connaissent, ils sont nombreux à s’inspirer de moi, à ce que j’apporte parce que je défends nos valeurs. Je joue à la batterie dans «ö Cameroun» de Elvis Kemayo, ‘‘Lambo la Tamba’’ de Douleur… Quand les gens achetaient les disques de makossa, il fallait lire sur la pochette les noms des musiciens, pourtant ça n’intéresse pas le grand public. Il n’y avait que les musiciens qui cherchaient à savoir.
N’y avait-il pas encore d’oreilles au Cameroun prêtes à écouter le jazz, votre musique de recherche ?
Il n’y en avait pas et il n’y en a pas encore. Je suis heureux que beaucoup de jeunes me suivent mais il y a encore du chemin.
Nous sommes sur la voix de la perdition, musicalement parlant ?
Je suis un musicien, j’écoute toutes les musiques, les chanteurs. Même si ici, on a tendance à tout globaliser, on appelle les chanteurs musiciens, on appelle les musiciens, chanteurs. Il y en a qui se démarquent, comme Richard Bona, Etienne Mbappe. Richard Bona aurait pu faire de l’instrumental aussi, mais comme il chante, ça passe mieux. D’ailleurs on nous disait qu’il faut faire la musique dansante, mais Richard Bona ne fait la musique dansante pourtant les gens l’écoutent.
C’est quoi le Kû Jazz que vous promouvez ?
Le Kû chez les Bafang ou les Bangangté signifie authentique. Je m’inspire de notre musique authentique et du jazz parce qu’il est libre. Dans la musique traditionnelle, vous voyez bien que tout le monde improvise. C’est du jazz, parce que jazz égal liberté. C’est la raison pour laquelle j’appelle ma musique le Kû Jazz.
Lire aussi :Démystifier le Jazz : André Manga donne la mesure
Est-il aisé de se construire une carrière de musicien au Cameroun ?
Cette question…non. Ce n’est pas aisé. Mais de toutes les façons je vais continuer parce que j’aime la musique. Ça fait des années que je viens au Cameroun, je regarde. Mais il faut payer les journalistes pour obtenir des passages, je ne suis pas dans cette logique. Bon, c’est aussi de ma faute, je n’ai pas bien communiqué. C’est compliqué. Moi je suis indépendant, j’organise tous mes spectacles en France avec mon association. Ici j’ai toujours entendu «ta musique est très compliquée, les Camerounais aiment le tapage, il faut leur faire du bruit». Je fais la musique vraie, authentique et c’est cette musique que je transmets. Les Camerounais ne connaissent pas tous les rythmes qu’on a. on est trop riche, mais les gens se ferment ou pis ils s’ouvrent à l’extérieur pourtant je suis connu à l’extérieur parce que je fais la musique de chez nous.
La polyrythmie est ancrée en vous. Comment ça se fait ?
Dans nos musiques traditionnelles c’est complètement la polyrythmie. La polyrythmie c’est la complémentarité des phrases, des notes.
A quand remonte votre dernière scène au Cameroun ?
La dernière scène au Cameroun remonte à très longtemps. C’est depuis 1999, j’avais été invité à jouer avec mon groupe par l’Institut français. Le souvenir que j’ai de cette scène est que les musiciens aiment mon approche. On m’appelle la bibliothèque, la source d’inspiration.
Actuellement, quel projet vous occupe ?
J’ai été invité par Philippe Essaka pour un master class. Je vais apprendre aux musiciens ce que je sais faire. Je vais aussi amener de la musique aux musiciens qui lisent et apprendre à ceux qui ne lisent pas. Je vais leur faire jouer des choses, des rythmes qu’ils n’ont pas l’habitude de jouer, le musicien doit tout expérimenter.
Vous avez tissez une expérience solide grâce aux rencontres sur votre parcours comme Manu Dibango, Uta Bella, Salif Keita, Miriam Makeba, Jean Luc Ponty… Qu’est-ce que toutes ces rencontres vous ont apporté ?
Elles m’ont apporté la force que j’ai aujourd’hui. Déjà j’ai joué avec tous ces gens parce qu’ils voulaient jouer avec moi. Ils savent que je me donne. Dans l’album ‘‘Waka Juju’’ de Manu Dibango, il y a pleins de mes idées. Je dois vous préciser que je ne suis pas que batteur. Je suis un compositeur et un concepteur. C’est moi qui compose l’album ‘‘Tchokola’’ de Jean Luc Ponty. Il m’avait appelé des Etats-Unis pour me dire qu’il fait un disque africain. Je lui ai demandé de venir chez moi, une semaine plus tard il était là et je lui ai présenté le concept. J’ai appelé les musiciens et quand on regarde la pochette, tout le monde est compositeur. Y en a marre aussi des Africains, qui restent, un Blanc vient te voir, t’exploite, tu lui donnes tout et c’est lui qui est compositeur. Non. Avec moi ça ne marche pas comme ça. Je l’ai toujours défendu, parce que je suis fier de ce que je suis. Dans Jean Luc Ponty, nous sommes tous compositeurs et tout le monde a bien profité.
Vous puisez une grosse partie de votre musique dans le terroir, pour quelqu’un qui est parti à 17 ans…
C’est parce que je venais beaucoup au pays. Il y a des moments, je venais deux fois par an. Je venais à l’époque d’Ahidjo pour les fêtes du 20 mai. Je suis venu plusieurs fois et c’est d’ailleurs ainsi que je rencontre Manu Dibango. On était venu à un festival au stade Ahmadou Ahidjo où on avait joué. Manu avait déménagé de la Côte d’Ivoire pour s’installer en France, et il m’avait dit «petit, dès que tu rentres à Paris, appelle-moi». C’est comme ça que je commence à jouer avec lui. Mais avant lui, je jouais avec Uta Bella, les Toure Kunda, Pierre Akedengue, parce que j’étais presque le seul batteur à l’époque à Paris, avant qu’arrivent les Valery Lobe, Jojo Kouoh. Les autres vagues longtemps après c’est les Guy Bilong.
Lire aussi :Guy Bilong : «Le seul qui n’avait jamais chanté s’est mis à bander comme un Turc»
Comment peut-on être aussi attaché à ses racines camerounaises et africaines, malgré toute une vie ailleurs ?
Dans ma musique, mes racines se ressentent. Je suis Bafang, de Bankondji. Mon père s’appelait Lucien Wouassi. Je suis reconnu en occident parce que ma musique exalte notre identité culturelle. Je n’ai jamais bougé de ligne et je continuerai ainsi.
Avec autant de réalisations, qu’est-ce qui peut bien encore vous manquer ?
Je n’ai pas assez joué. Il faut que je joue, il faut qu’on m’invite jouer. Je profite de l’occasion pour remercier les personnes comme Debalois, Philippe Essaka parce que ça fait des années que je viens, que je rencontre des gens qui promettent de m’appeler, et puis rien. Quand Philippe m’a dit qu’il m’appellerait lors de notre rencontre à Yaoundé, j’avais noté son numéro en me disant que lui aussi n’appellera pas. Je n’en reviens pas qu’il l’ait fait. Je suis très content de les rencontrer parce qu’on a la même vision. Exprimer son art s’il est populaire est une bonne chose mais même si c’est pour un petit public pour commencer, ce n’est pas grave. Nous voulons des gens qui nous écoutent, qui peuvent s’asseoir et apprécier le travail de quelqu’un. Je travaille aussi avec des plasticiens, parce que j’ai des projets avec des plasticiens, des musiciens, des poètes au Cameroun. Le projet s’appelle Guantanamo. Avant ce projet, j’ai fait le Kelin-kelin en orchestre. Je voulais faire un orchestre de Noirs, avec Jean Jacques Elangue. Nous l’avons fait pendant cinq ans, sans sponsors. Nous avons même envoyé pleins de dossiers au Cameroun, mais ça ne rien dit à personne. Nous avons fait un disque, parce qu’il y avait quelques gars qui nous supportaient, mais c’est fatiguant.

Quelle est la spécificité du projet Guantanamo ?
Déjà, j’ai fait le choix de ce nom, bien évidemment avant le covid, parce que je trouve que nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Nous sommes en prison, quand on regarde comment le monde tourne actuellement. Ça ne va pas. Dans le Guantanamo on se libère, on joue, c’est la spontanéité. Pendant qu’on joue, le plasticien est inspiré et réalise sa peinture.
Comment définissez-vous votre musique ?
Ma musique est libre. Un musicien doit s’exprimer. On ne doit être fermé, surtout que nous sommes des musiciens modernes aujourd’hui. On a d’autres influences. Mais l’essence, le «Kû Jazz» reste. Je connais tous les rythmes de chez nous, de l’Afrique et c’est ce que j’apprends aux gens parce qu’en dehors de jouer, il faut savoir respirer aussi. Les master-class serviront également à ça. J’utilise aussi la danse corporelle.
Vous avez assuré la direction musicale de Salif Keita pendant six ans. Comment s’est faite votre rencontre ?
J’avais arrêté de jouer avec Manu Dibango, et j’ai vu Mamadou Konte –réalisateur, fondateur de l’Africa Fête Music Festival). Il m’a dit que Salif vient de finir avec les ambassadeurs, il lui faut quelqu’un comme toi. D’ailleurs j’ai appris à chanter en jouant, parce que je mimais la musique de Salif puisqu’on je répétais avec les musiciens un mois sans Salif. C’était très bien, j’étais bien payé, les musiciens aussi.
S’il fallait remercier un pays qui vous a aidé à vous réaliser, quel nom donneriez-vous ?
Je dirai tout de suite la France. Et j’ai beaucoup d’expériences sud-africaines, parce que j’ai réalisé pas mal d’albums. En passant, je suis le réalisateur de l’album «Béza ba dzo» d’Anne Marie Nzie, sorti en 1998. Sauf qu’une fois de plus ici, mon nom était écrit en petit caractère sur la pochette. On ne m’a pas mis à l’honneur. Pour revenir à votre question, il y a la France, puis l’Afrique du Sud. La France parce que c’est quand même là qu’on a entendu qu’il y a un gars qui sait jouer. C’est là qu’on me donne tout le respect auquel j’ai droit. L’Afrique du Sud pour les mêmes raisons. J’y ai produit pas mal de groupes parce que je travaillais pour ma maison de disque anglaise. Le producteur de ma maison de disque m’envoyait réaliser des groupes. C’est ainsi que j’ai réalisé Ama Mpondo par exemple, avec une super chanteuse qui n’est plus de ce monde, Busi Mhlongo. Il y a un album qui s’appelle «Urban Zulu», je vous conseille d’aller écouter le travail que je fais derrière. J’ai beaucoup travaillé pour elle, et à un moment donné, je vivais en Afrique du Sud. J’ai fait tous leurs grands conservatoires parce qu’ils me donnent l’honneur que je mérite. L’honneur que je n’ai pas au Cameroun et que j’attends.

Reparlons des frustrations que vous avez essuyées jusqu’ici…
Vous avez l’affaire du nom sur la pochette de «Béza ba dzo». Il y a des gens comme Christian Mousset avec qui je ne parle plus. Ce sont des escrocs qu’on amène ici en leur faisant passer pour des producteurs. Ils ont fait du mal à la musique africaine, de connivence avec Christian Mousset qu’on appelle Monsieur l’Africain. C’est lui qui décide de tout, et quand nous autres parlons, on nous écarte. J’ai fait Anne Marie Nzie, je n’ai même pas été invité ici. Il aurait fallu que je sois un Blanc, peut-être. Là, je suis vraiment en colère. Ce n’est pas normal. C’est vrai, je suis quelqu’un de humble, je n’ai rien dit, mais à mon âge, on doit parler.
Quel souvenir gardez-vous de votre première vraie scène ?
Ce festival qu’on avait fait au Stade Ahmadou Ahidjo à l’occasion du 20 mai 1978 et 1979. J’étais aussi avec Uta Bella. C’était ma première fois de jouer dans un stade. C’était grandiose déjà que jouer dans un stade c’est quelque chose. La petite histoire c’est que quand j’étais encore ici, en 1970 il y avait un festival au stade Ahmadou Ahidjo. Manu est venu avec son orchestre pour jouer dans le stade et j’ai dit «un jour je vais jouer avec ce type».
Y-a-t-il de jeunes musiciens camerounais qui vous marquent ?
Il y a beaucoup de musiciens à Yaoundé comme les Kemite, Macase, j’aime beaucoup cette génération. Ils ont bien compris les leçons. Le seul bémol est qu’il faut veiller à ne pas se prendre la tête, à garder les pieds sur terre et à avoir une bonne hygiène de vie. Je vois des mecs de 43 ans qui sont plus vieux que moi, ils ont la bedaine.
Quel est justement le secret de votre ligne, de votre jeunesse ?
Le sport, la musique. Je mange la musique. Je peux manger une fois par jour, ça me va. Pas besoin de manger trois fois. Je fais aussi des claquettes, je joue du saxophone. Je passe mon temps à jouer en fait.
Quel est votre rêve pour la musique camerounaise et africaine ?
Il faudrait qu’on ait des gens qui écoutent et savent apprécier la musique, et qui vont nous payer normalement. Que nous ne soyons pas comme des quémandeurs. Vous vendez votre disque à quelqu’un, il le regarde avec dédain. Si la même personne te voit jouer sur scène, il va te «farotter» un montant supérieur au prix de vente de ton disque, parce qu’il vient faire son show sur scène. Je conseille souvent aux jeunes musiciens que je forme de savoir donner un peu pour la connaissance. Même si c’est 1000FCFA, ça prouve que tu veux apprendre et que tu respecte les années de connaissances acquises par celui qui t’enseigne. Quand tu leur donnes des cours gratuits, après ils ne te respectent plus, ce sont les premiers à dire «il joue même quoi ?». Et le constat est pareil hors du cadre de la musique. Tu vas dans un bureau, on te parle n’importe comment, sans un bonjour. Ça me tue un tel comportement.
Décryptée par Valgadine TONGA