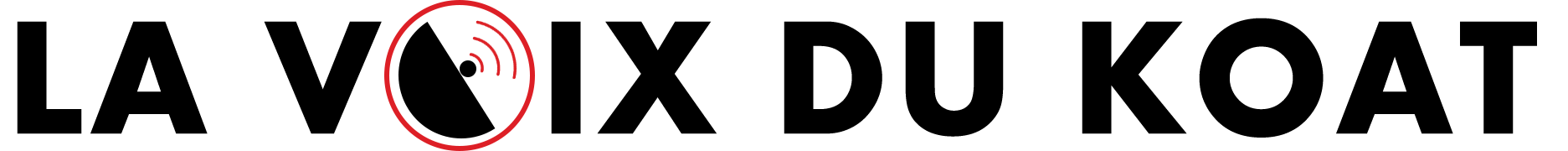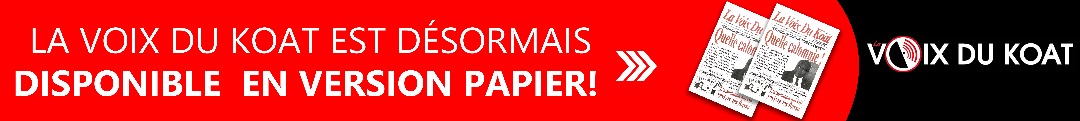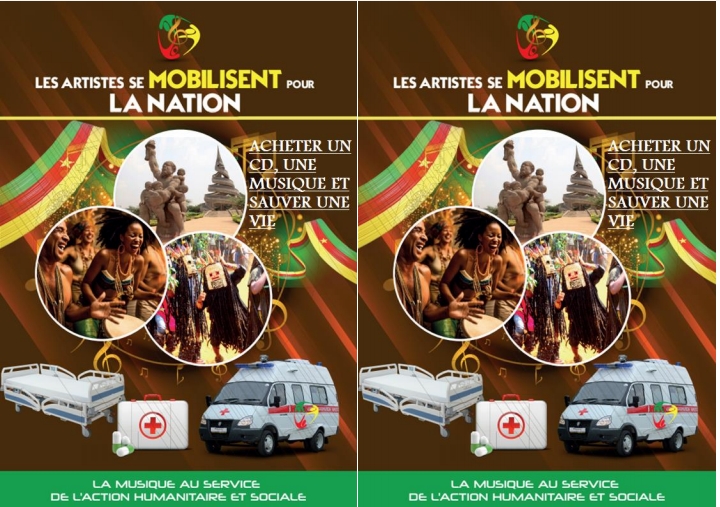Des leaders des communautés forestières d’Afrique et d’Asie interpellent des banques Néerlandaises impliquées dans le financement des agro-industries d’huile de palme.
Amsterdam Zuid, Octobre 2019. Vêtue d’un blouson velours pour se protéger du froid, la jeune Harriet Sayee Saylee, infirmière dans la communauté Numopoh au Liberia brandit avec détermination un format A4 sur lequel elle a couché à l’encre bleu son message. « Lorsque l’entreprise Golden Veroleum Liberia (GVL) a annoncé qu’elle venait s’installer dans notre communauté pour produire le palmier à huile, tout le monde était content, car il n’y avait pas d’emploi et il nous avait été dit que tout allait changer. En 2014, nous avons signé un Mémorandum d’entente (MoU) avec GVL, mais cela n’a pas été fait en tenant compte notre Consentement libre, éclairé et informé. En plus, des policiers nous intimidaient. Aujourd’hui, cinq ans après, GVL n’a pas respecté ses obligations”, raconte avec amertume la jeune mère de 3 enfants. Debout, devant la direction de la banque Néerlandaise ABN-AMRO, Harriet est la seule femme du groupe de 4 visiteurs inhabituels venus d’Indonésie et du Libéria pour rencontrer les responsables de la banque.
Déforestation, dégradation des terres des communautés, violences sur des membres des communautés riveraines aux palmeraies des agro-industries, accaparements de terres et emprisonnements des leaders communautaires, de tels faits s’enregistrent tant au Libéria, en Indonésie que dans le Bassin du Congo, où les agro-industries d’huile de palme et d’hévéa gagnent en influence au fil des années. Les rapports entre les communautés et les agro-industries sont très conflictuels d’après Ghislain Fomou, expert en Gouvernance Forestière au Service d’Appui aux Initiatives Locales (SAILD), ONG dont les activités couvrent le Bassin du Congo. « Durant la phase d’attribution de la concession, les conflits sont dus à l’accaparement des terres villageoises par les agro-industries et au non-respect de leurs droits coutumiers et traditionnels. Pendant les phases d’exploitation, il y a un faible respect des engagements sociaux des entreprises agroindustrielles », explique Ghislain.
Earthsight affirme à ce sujet que « les plantations industrielles constituent une menace énorme pour les forêts et les populations du Bassin du Congo ». Dans une étude publiée en 2018, cette organisation rapporte qu’ « entre 2011 et 2017, environ 500 kilomètres carrés de forêt naturelle ont détruites au bulldozer et converties en plantations de palmier à huile et d’hévéa dans le Bassin du Congo. Le développement le plus rapide a été enregistré au Gabon avec « les plantations de palmier à huile et d’hévéa de l’agro-industriel Olam qui auraient engendré la destruction de 35 mille hectares de forêt dense », ajoute Earthsight. La multinationale Olam International Limited a signé un partenariat avec le gouvernement Gabonais pour créer Olam Palm Gabon SA qui détient près de 144 mille hectares de terre pour la production du palmier à huile.
En République Démocratique du Congo et au Cameroun, le groupe Socfin, filiale du groupe Bolloré exploite de vastes plantations de palmier à huile. Des communautés riveraines à Socapalm, branche Camerounaise de Socfin dénoncent de nombreux cas de violations de droits dont des agents de l’agro-industrie seraient des auteurs. Même si ces agro-industries semblent détenir un grand pouvoir face aux communautés, elles dépendent de gros investissements financiers pour mener à bien leurs activités.
Secteur attractif
Selon des experts, « l’agro-industrie de palmier à huile est rentable, mais le coût financier initial pour démarrer la plantation est très élevé, ce qui oblige les compagnies à faire recours aux financements externes », en l’occurrence les banques. « De grands noms du secteur financier mondial, dont Barclays, des banques Néerlandaises, HSBC, Standander et Standard Chartered entre autres, auraient déboursé des dizaines de milliards de dollars entre 2013 et 2019 dans le financement des compagnies agro-industrielles qui directement ou indirectement contribuent à la destruction des principales forêts tropicales », révèle un rapport de l’ONG Global Witness publié en Septembre 2019. Global Witness y montre l’existence de liens financiers entre de banques internationales et six principales agro-industries, dont deux en activité dans le Bassin du Congo.
Des données financières montrent qu’au sein de l’Union Européenne, les banques Néerlandaises jouent un grand rôle dans le financement des agro-industries. En 2016, FERN classait trois banques Néerlandaises à savoir ABN AMRO, ING et Rabobank dans le top 10 des banques Européennes ayant fait des prêts bancaires aux agro-industries d’huile de palme entre 2010 et 2015. En Juillet 2018, ces trois banques Néerlandaises sont épinglées dans un rapport de Milieu Defensie « En ces 8 dernières années, l’argent venant de ABN AMRO, ING et Rabobank a directement été utilisée pour financer des compagnies de palmier à huile qui oppriment les communautés locales et détruisent des forêts précieuses », révèle l’étude Draw the Line. C’est ce qui motive les jeunes leaders d’Indonésie et du Libéria à présenter leurs plaintes aux responsables des Banques Néerlandaises.
Des partenaires desdites banques opèrent dans le secteur de l’huile de palme dans plusieurs pays tropicaux. Et le Bassin du Congo n’est pas épargné. Selon le rapport Draw the Line, Olam International Limited qui détient des plantations au Gabon a des liens financiers avec trois banques Néerlandaises que sont : ABN-AMRO, Rabobank et ING. Le même document montre l’existence de liens financiers entre Socfin et les banques ABN-AMRO et ING. Le rapport de Global Witness montre que des parts de la multinationale Bolloré S.A figurent dans 2 des 56 fonds d’investissements incluant des parts des compagnies agro-industrielles d’huile de palme qu’offre la banque ABN AMRO.
Toutes ces trois banques Néerlandaises sont pourtant membres de la Table Ronde sur l’Huile de Palme Durable (RSPO). Un tour sur leurs sites internet permet effectivement de constater que chacune des trois banques a mis sur pied de durabilité excluant le financement des entreprises qui contribuent à la déforestation ou à la violation des droits humains. Pour Global Witness « Il y a un seul problème: les mêmes institutions financières, très souvent violent leurs règles ».
Madeleine NGEUNGA (Cp)